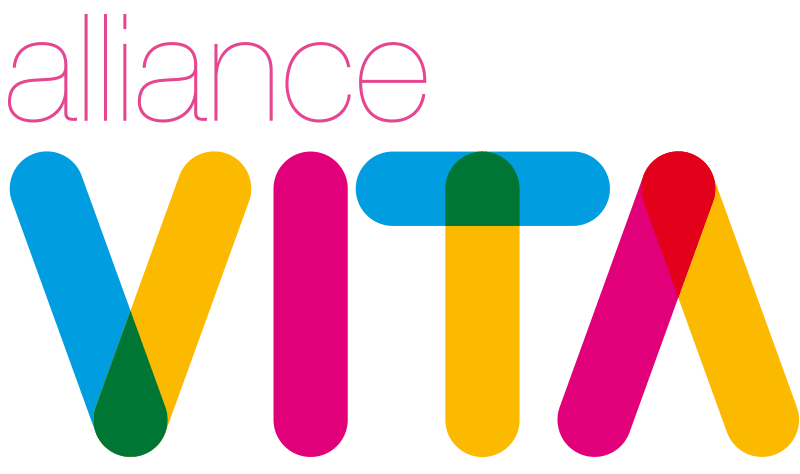Jeunes placés à l’ASE : une précarité résidentielle qui perdure (INED)
Jeunes placés à l’ASE : une précarité résidentielle qui perdure (INED)
L’INED a publié, en avril 2021, une étude sur les difficultés de logement des jeunes après un placement, à partir des données de l’enquête ELAP (Étude longitudinale sur l’accès à l’autonomie après le placement), menée en 2013 et 2015 : parmi les enquêtés, 36% jugent que « leur prise en charge s’est arrêtée trop tôt », 16% ont connu la rue depuis leur sortie, quand la décision de fin de placement a été la décision unilatérale de l’Aide Sociale à L’Enfance (ASE).
L’enquête a été réalisée en deux vagues, en 2013-2015 et en 2015, auprès de 1 622 jeunes âgés de 17 à 20 ans avec comme objectif de mieux connaître les conditions de sortie et leurs conditions de vie dans le placement à la veille de leur sortie et après. Elle peut aider à orienter les efforts des pouvoirs publics pour améliorer les trajectoires de sortie de l’ASE.
En France, 138 000 enfants sont pris en charge par l’ASE, au titre de l’enfance en danger, soit 1,6% des mineurs : cela englobe soutien matériel, éducatif et accompagnement des jeunes. Si les enfants ont rejoint le dispositif à différents âges, ils ont en commun de devoir en sortir à 18 ans et subvenir à leurs besoins. En 2019, la Fondation Abbé-Pierre, dans son rapport 2019 sur l’état du mal-logement, alertait : « Un quart des SDF nés en France sont d’anciens enfants placés ». Cela représente 10 000 personnes. « Ce taux atteint 36% parmi les jeunes sans domicile ente 18 et 25 ans ».
« Etre majeur, ne signifie plus être autonome »
Depuis 1974, alors que la majorité est passée de 21 ans à 18 ans, un dispositif a été mis en place : le contrat jeune majeur, pour accompagner les jeunes au-delà de 18 ans. « Alors que le contrat engage le jeune à ne pas abandonner une formation professionnelle, des études, l’ASE est engagée à respecter ses obligations. L’hébergement est encore à la charge de l’ASE : le jeune peut loger chez une assistante familiale départementale, en appartement, dans une chambre d’hôtel, en foyer. Le jeune reçoit un accompagnement psychologique, une aide financière ainsi qu’une aide pour la scolarité. »
La durée du contrat s’élève à un an. Il peut être renouvelable. En effet « être majeur, ne signifie plus être autonome, ni être indépendant. » soulignent les auteurs du rapport « Sortir de la protection de l’enfance à la majorité ou poursuivre en contrat jeune majeur », publié en 2018. « En population générale, seulement 17% des jeunes de 18 à 24 ans disposent de leur propre logement qu’ils financent eux-mêmes. Les autres décohabitants (26%) dépendent tout ou en partie de leurs parents qui financent le logement et 57% vivent toujours chez eux ».
Des parcours marqués par l’instabilité résidentielle
Selon l’étude, près de la moitié des jeunes placés (âgés de 17 à 20 ans) étaient passés par « au moins trois lieux de placement » et plus du tiers déclarent qu’ils ont dû quitter des lieux dans lesquels ils auraient souhaité rester. « La prise en charge par l’ASE les expose à un « ballotage » de structure en structure. » A cela s’ajoute le manque de place dans les structures d’accueil et des restrictions budgétaires qui conduisent à faire sortir les jeunes pour accueillir de nouveaux entrants.
C’est ainsi que la majorité déclare n’avoir pas choisi le moment du départ. D’où le risque de se retrouver sans abri. Par contre ce n’est pas le cas quand le départ est vécu comme anticipé et consenti.
Une dégradation de l’application du contrat jeune majeur.
L’étude conduite en 2018 pré citée a mis en évidence le bénéfice de la mesure contrat jeune majeur, « pour la poursuite des études et même sa nécessité pour rattraper le retard scolaire afin d’obtenir un diplôme au moins supérieur au BEPC.
L’aide aux jeunes majeurs permet aussi d’acquérir tout un ensemble de compétences peu accessibles avant la majorité ou mal anticipées (comme le permis de conduire, l’expérience professionnelle, la constitution d’un pécule, la mise en place d’un compte en banque, le relais avec les aides de droit commun, etc.) ».
Cependant depuis 40 ans qu’elle a été mise en place, on constate une dégradation de son application, en grande partie pour des causes budgétaires, se focalisant sur les jeunes qui ont des projets. « L’aide par projet n’accorde que peu de place à ceux qui n’en n’ont pas ou qui n’en n’ont plus. » D’où la nécessité de revoir l’application de cette mesure pour l’adapter aux besoins actuels.
Une proposition de loi visant à renforcer « l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie » a été votée en première lecture en 2019 à l’Assemblée nationale. Elle vise à assouplir le système et à le poursuivre au-delà de 21 ans pour tenir compte également des études plus longues et du temps de l’insertion professionnelle et d’acquisition de l’autonomie. Pour le moment, le processus législatif n’a pas été encore poursuivi au Sénat.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :