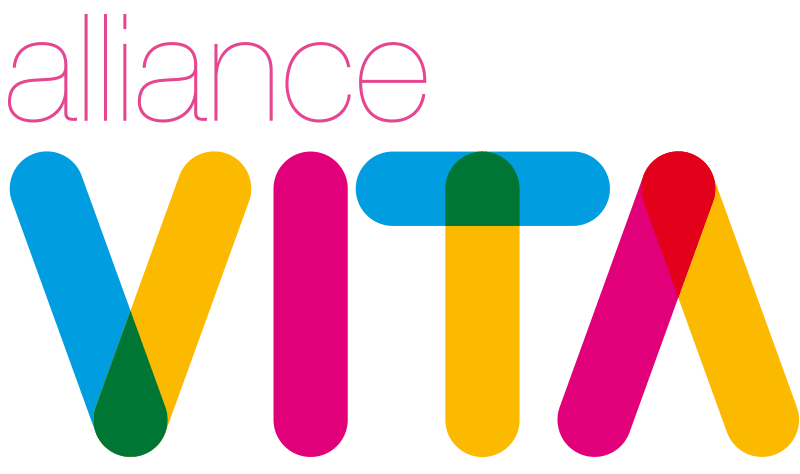Une loi pour l’euthanasie mais contre la raison
Le morbide scénario se confirme : des trois propositions de loi sur l’euthanasie, la commission des affaires sociales du Sénat réunie mardi dernier a fait une synthèse. Ce texte sera discuté en séance au Sénat ce mardi 25 janvier. Et le résultat du vote est incertain.
Toute personne qui présenterait une « souffrance physique ou psychique (…) qu’elle juge insupportable » se verrait ainsi en droit de se voir administrer « une mort rapide et sans douleur. »
Derrière ce texte, la manipulation est évidente, nous l’avons déjà dénoncée. Jean-Pierre Denis, l’éditorialiste de La Vie, nous en apporte une confirmation supplémentaire dans le dernier numéro de l’hebdomadaire, en dénonçant la position très particulière de Mme Muguette Dini qui préside la commission des affaires sociales du Sénat et se trouve être, dans le même temps, membre du comité de parrainage de l’ADMD, le lobby très acrimonieux de l’euthanasie !
Le contexte est donc préoccupant. Les français sont mal informés sur la fin de vie, sur les soins palliatifs et la réalité que cache le terme euthanasie. Le sondage Opinion way publié la semaine dernière nous apprend que 68 % des français pensent qu’il n’existe pas en France de loi les protégeant de l’acharnement thérapeutique. Quant on leur propose le choix, pour un proche gravement malade, entre la piqûre létale et des soins palliatifs de qualité, 63 % choisissent les soins palliatifs (heureusement …) mais il en est quand même 36 % à privilégier l’injection mortelle !
Evidemment, ce n’est pas neutre que ce débat sur l’euthanasie surgisse en même temps que la révision des lois bioéthique et la discussion sur la dépendance. Ces questions sont en lien et nous renvoient aux deux grandes tentations du siècle dernier. La première rêvait d’un « homme nouveau », elle transparaît aujourd’hui dans les implications eugéniques de la bioéthique. La deuxième projetait de purifier l’espèce. Elle est maintenant visible dans la tentation euthanasique et la question de la dépendance. L’homme idéal serait autonome, actif, productif, bien-portant. La personne dépendante, fragile ou handicapée fait figure de « parasite ». Devenue une charge pour la société et pour ses proches, elle se croit déchue de sa dignité et réclame la mort. Imparable !
On le sait, il n’y a pas de totalitarisme plus abouti que celui qui voit les citoyens combattre pour leur propre servitude. De même, il n’y a pas d’eugénisme plus sournois et discriminant que celui que verra les citoyens arbitrer de leur propre dignité. Car, face au miroir, il n’est point de juge plus intransigeant que nous-mêmes. La revendication euthanasique s’affiche comme une liberté puisqu’elle ne serait pas contraignante. C’est oublier un peu vite que les conventions sociales et la psychologie pèsent plus que la loi pour influencer nos pratiques. Quelque soit l’issue du débat, l’existence même de celui-ci nous en dit donc long sur la société française.
Heureusement, de nombreuses voix s’élèvent pour s’indigner de ce texte de loi mal ficelé, présenté à la va-vite et presque en catimini sans réel débat de société. Contre ce texte qui voudrait, face à la souffrance, renverser nos réponses et nous contraindre à récuser le soin pour privilégier ce qui pourrait bien ressembler à une sorte d’épuration, ça coince ! D’ailleurs, signe de mobilisation, la pétition contre l’euthanasie sur le site « Faut pas Pousser » a réuni presque 50000 signatures et celle du site « Plus Digne la Vie » en regroupe plus de 10000.