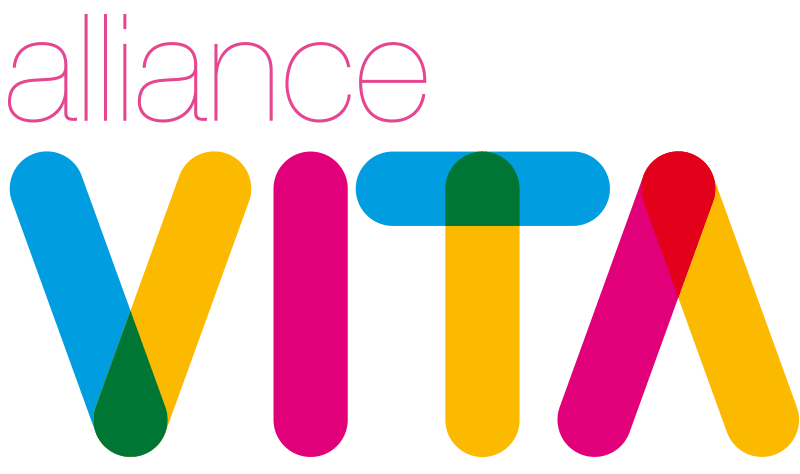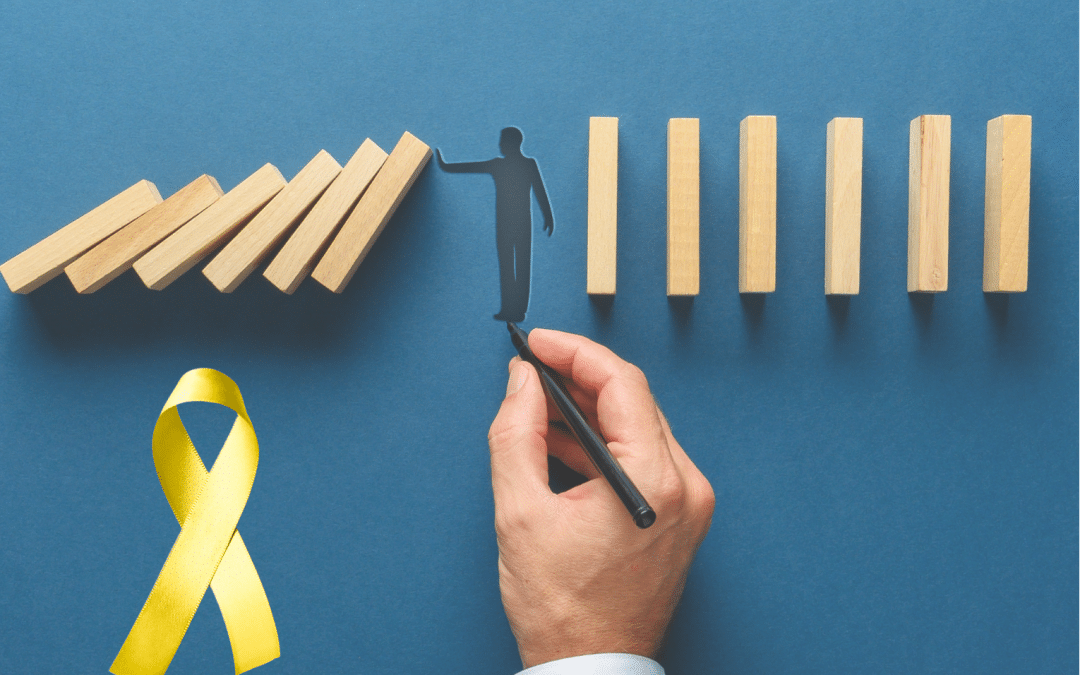Les clauses de conscience reconnues en France
Les clauses de conscience reconnues en France
La liberté de conscience
La liberté de conscience est reconnue comme une valeur éthique essentielle dans tous les grands textes internationaux. Elle figure notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 18), dans la Convention européenne des droits de l’homme élaborée par le Conseil de l’Europe (article 9), ou dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 10).
En France, elle constitue un « principe fondamental reconnu par les lois de la République », c’est-à-dire une norme de valeur constitutionnelle, supérieure aux lois ordinaires qui ne doivent donc pas y porter atteinte.
L’objection de conscience
L’objection de conscience consiste à refuser d’accomplir certains actes prescrits par la loi ou par les représentants de l’autorité en général, parce que contraires à des normes morales, éthiques ou religieuses fondées sur la liberté de conscience.
La clause de conscience
La clause de conscience est la reconnaissance par l’Etat de ce « droit d’opposition », dans certains cas précis où des valeurs fondamentales sont en jeu.
En l’absence de clause de conscience officiellement reconnue, chaque citoyen garde le droit et le devoir d’exercer sa liberté de conscience, dans des cas graves de lois considérées comme injustes ou illégitimes, même au prix de se mettre « hors-la-loi ».
Dans le secteur des médias
Le cas de figure le plus ancien concerne les journalistes, depuis une loi de 29 mars 1935. Elle leur permet, en cas de changement de propriétaire ou de la ligne éditoriale de l’organe de presse, de démissionner tout en entrainant l’application des avantages du licenciement (indemnités de licenciement et allocation chômage). L‘article L7112-5 du code du travail a donné lieu à une distinction entre « clause de conscience » et « clause de cession », avec le même objectif.
Dans le secteur juridique
Il existe une règle assez particulière au bénéfice des avocats, qui figure dans le règlement intérieur de cette profession. Selon un principe traditionnel, l’avocat peut refuser de défendre une affaire lorsque, en conscience, il estime qu’il ne peut assurer l’assistance ou la défense de la personne qui le sollicite. Il n’a pas à se justifier, même lorsqu’il est commis d’office.
Dans le secteur de l’armée et de la police
Le statut légal de l’ « objecteur de conscience » a été créé en 1963, au temps où le service militaire était obligatoire, pour les jeunes se déclarant opposé à l’usage personnel des armes pour des motifs de conscience. Ce statut permettait d’accomplir une forme de service civil auprès d’une association, en France où à l’étranger, mais d’une durée deux fois plus longue que celle du service militaire. Celui-ci ayant été supprimé à partir de 2001, le statut d’objecteur de conscience a disparu également.
Le « devoir de désobéissance », pour les militaires ou les policiers, se situe sur un plan un peu différent : le subordonné doit refuser d’exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal. Dans ce cas, la désobéissance s’exerce à l’égard de la décision individuelle d’un supérieur hiérarchique, et non pas à l’égard d’un texte légal. Elle vise à appliquer correctement une loi juste, alors que l’objection de conscience vise à ne pas appliquer une loi injuste.
Dans le secteur médical
La clause de conscience est légalement reconnue dans trois situations :
1. L’interruption volontaire de grossesse
Il s’agit de la clause la plus connue, applicable depuis la loi du 17 janvier 1975 dépénalisant l’IVG : « Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l‘article L. 2212-2. Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse » (Article L2212-8 du code de la santé publique).
A noter que les pharmaciens ne sont pas considérés comme des auxiliaires médicaux, et ne sont donc pas concernés par cette clause.
2. La stérilisation à visée contraceptive
Une clause similaire vise, pour les seuls médecins, les cas plus rares de stérilisation à visée contraceptive, à la suite de la loi du 4 juillet 2001 : « Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l’intéressée de son refus dès la première consultation » (Article L2123-1 du code de la santé publique).
3. Les chercheurs sur l’embryon
La loi bioéthique du 7 juillet 2011 a introduit une clause de conscience pour les chercheurs, au sens large, qui sont impliqués dans les recherches sur les embryons humains : « Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l’article L. 2151-5 » (Article L2151-7-1 du code de la santé publique).