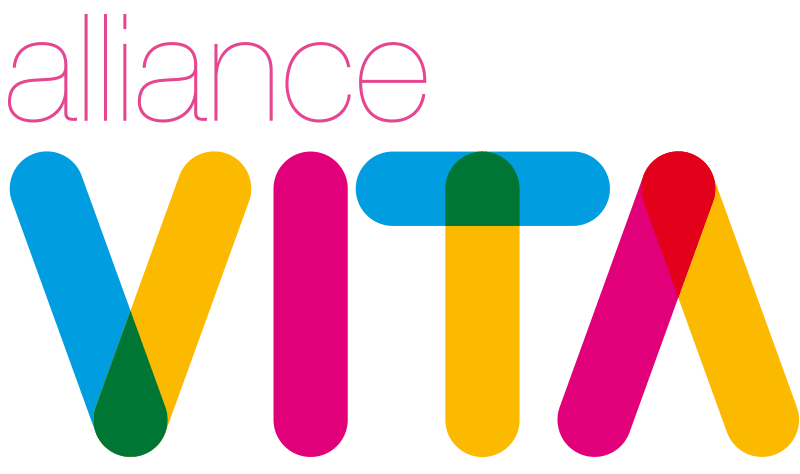Euthanasie : Le sondage manipulateur de l’ADMD
Ca y est ! Comme chaque année ou presque, l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) vient de publier son sondage pour démontrer que l’immense majorité des Français veut une loi autorisant l’euthanasie.
Cette fois, le record national est battu : 96% des Français seraient pour cette légalisation, avec 54 % répondant « oui, absolument » et 42% « oui, dans certains cas ». Ils n’étaient que… 92% en octobre 2013, ou 94% en octobre 2010. Plus de 90% des citoyens votant POUR une mesure aussi radicale, année après année, c’est digne d’un scrutin à la soviétique, avant la chute du mur de Berlin ! Dans notre pays frondeur, avec notre tempérament de tribus gauloises toujours prêtes à se diviser, n’est-ce pas très surprenant, voire tout à fait suspect ? Voyez-vous une telle unanimité pour réformer l’assurance-chômage, baisser les allocations familiales, réformer les rythmes scolaires, supprimer les départements, arrêter le nucléaire, etc ?
En réalité, les Français ont à répondre à une question mal posée, à une forme de piège dialectique. Une question qui induit tellement la réponse que vous ne pouvez que dire oui, sauf à paraître complètement fou ou inconscient. Reprenons la question posée par l’IFOP, toujours la même depuis des années (c’est nous qui soulignons les mots clés) : « Certaines personnes souffrant de maladies insupportables et incurables demandent parfois aux médecins une euthanasie, c’est-à-dire qu’on mette fin à leur vie, sans souffrance. Selon vous, la loi française devrait-elle autoriser les médecins à mettre fin, sans souffrance, à la vie de ces personnes atteintes de maladies insupportables et incurables, si elles le demandent ? » Donc nous avons d’un côté des « souffrances insupportables », et de l’autre une solution « sans souffrance ».
On répète l’opposition des situations extrêmes avec insistance, deux fois dans la même question : dites-moi, connaissez-vous beaucoup de personnes qui accepteraient de subir l’insupportable ? Par principe, si une situation ne peut être supportée, il faut y mettre fin immédiatement. Ce n’est pas 92 ou 96% des Français qui devraient répondre oui, mais 100% ! Nous sommes donc devant un choix truqué, une manipulation à visée idéologique qui retire toute valeur probante à ce sondage, comme à ceux des années précédentes.
La question est finalement du style : « Préférez-vous mourir d’une bonne crise cardiaque en quelques secondes sans vous en rendre compte, ou mourir d’une agression de 50 coups de couteau déclenchant une hémorragie interne et d’intenses souffrances pendant deux jours ? ». Ou encore, d’une façon plus générale pour ce genre d’opposition en blanc ou noir : « Préférez-vous être riche et en bonne santé ? Ou préférez-vous être pauvre et malade » ? On ne peut que répondre oui à la première question !
En sens inverse, imaginons l’alternative suivante : « En fin de vie à l’hôpital, préférez-vous : a) être pris en charge par une équipe de soignants compétents, capables de soulager vos douleurs pour vous permettre de profiter au mieux de vos derniers jours avec vos proches, ou b) ne pas être pris en charge médicalement et que l’on vous euthanasie ?» Nous pouvons affirmer sans grand risque que la réponse a) obtiendrait une large majorité. D’ailleurs, d’autres sondages confirment que les Français en général souhaitent des mesures qui les aident à mourir sans souffrir, mais dans un accompagnement fondé sur le respect de « l’interdit de tuer », le principe à la base de toute la confiance entre soignants et soignés. Nous ne sommes plus au temps où l’on devait amputer une jambe sans anesthésie.
Aujourd’hui en France, pratiquement toutes les douleurs physiques peuvent être soulagées correctement, les cas de souffrances insupportables et inapaisables sont devenus extrêmement rares (le chiffre de 2000 cas par an, parfois évoqué, correspondrait à 0,003% des décès). Citons par exemple ce sondage Opinionway de janvier 2011, très éclairant. A la question sur « quelle est la priorité aujourd’hui en France ?», 60% répondent « Voter des crédits pour développer des soins palliatifs de qualité » (et même 73% des 60 ans et plus), contre 38% qui choisissent « Légaliser l’euthanasie » : il n’y a plus qu’un gros tiers des Français qui demandent une loi pour favoriser la piqûre létale ! Et ce même sondage pose une question encore plus précise, plus personnelle : « Imaginez que l’euthanasie soit légale en France et qu’un de vos proches soit gravement malade. Personnellement, préfériez-vous… ? Qu’il bénéficie de soins palliatifs de qualité (63% des réponses), ou qu’on opère sur lui une euthanasie, c’est-à-dire une injection mortelle (36% des réponses) ». Conclusion claire : ce dont la France a besoin, c’est d’un développement majeur des soins palliatifs, promis par François Hollande en juillet 2012 mais jamais mis en œuvre depuis.
La plupart des adhérents de l’ADMD, quand on discute sereinement avec eux, veulent surtout ne pas souffrir en fin de vie, et pensent que l’euthanasie est la seule façon d’éviter l’acharnement thérapeutique. Mais si on leur propose un bon accompagnement médical et humain, la demande d’euthanasie disparaît. Sont par contre très minoritaires, ceux qui veulent à tout prix que la société puisse les « suicider », même sans douleur insupportable, à l’heure qu’ils ont choisie en revendiquant leur droit à l’autonomie. C’est dire combien un immense travail de pédagogie est nécessaire pour bien définir et expliquer ce que l’on met sous le mot « euthanasie »… Ne nous laissons pas manipuler !