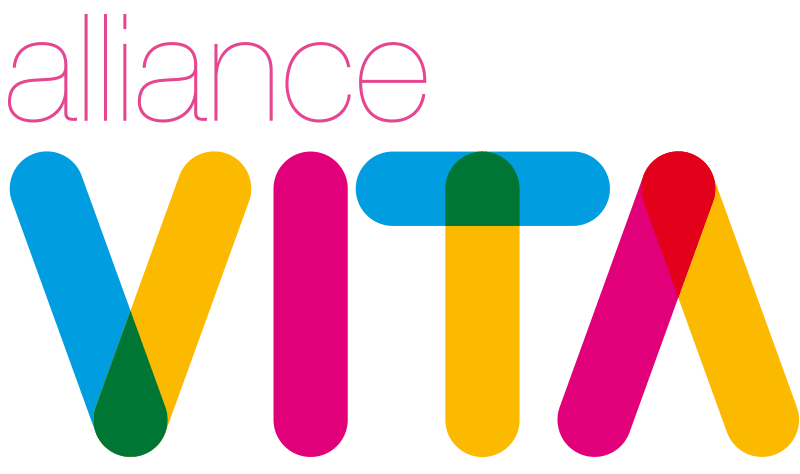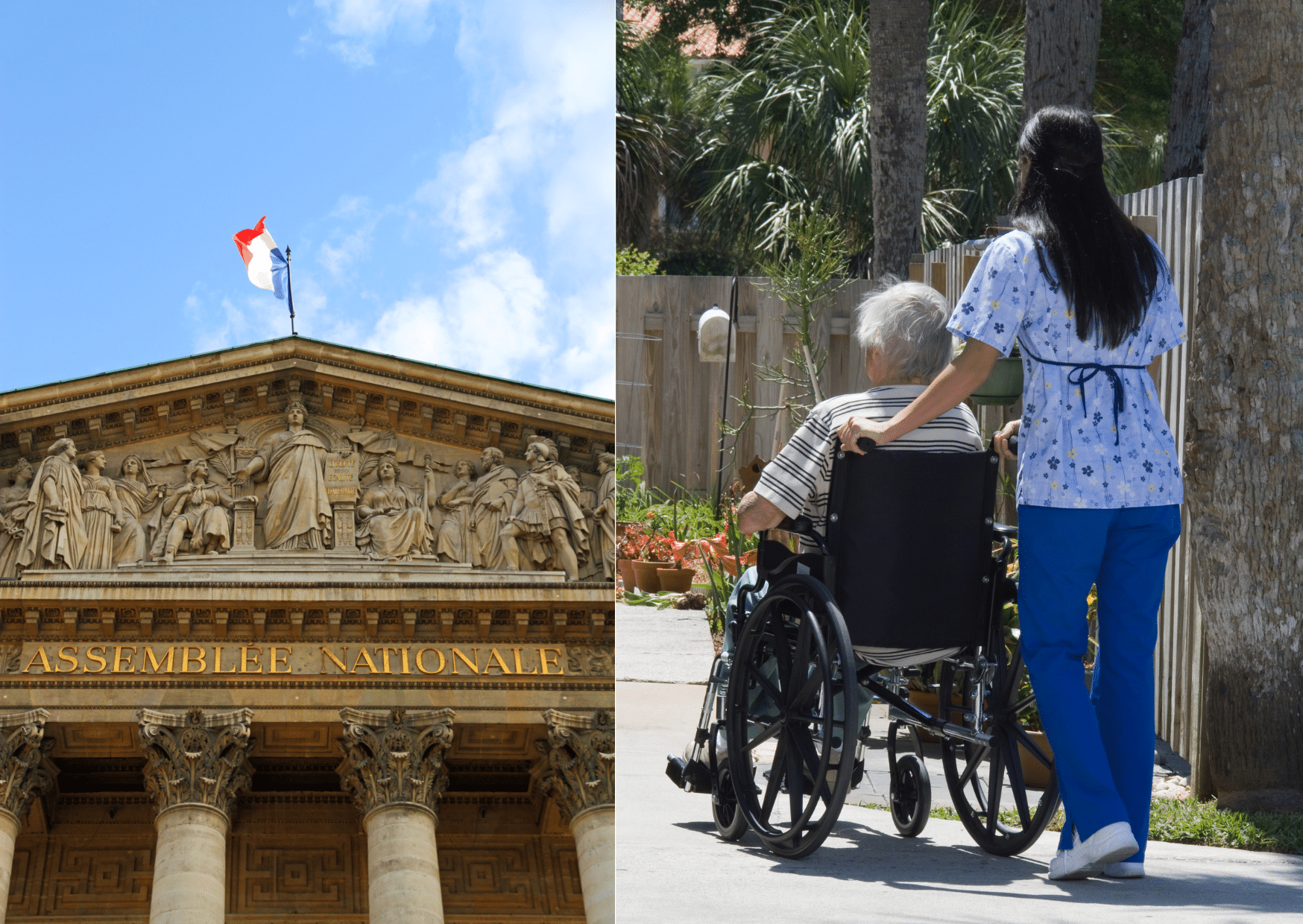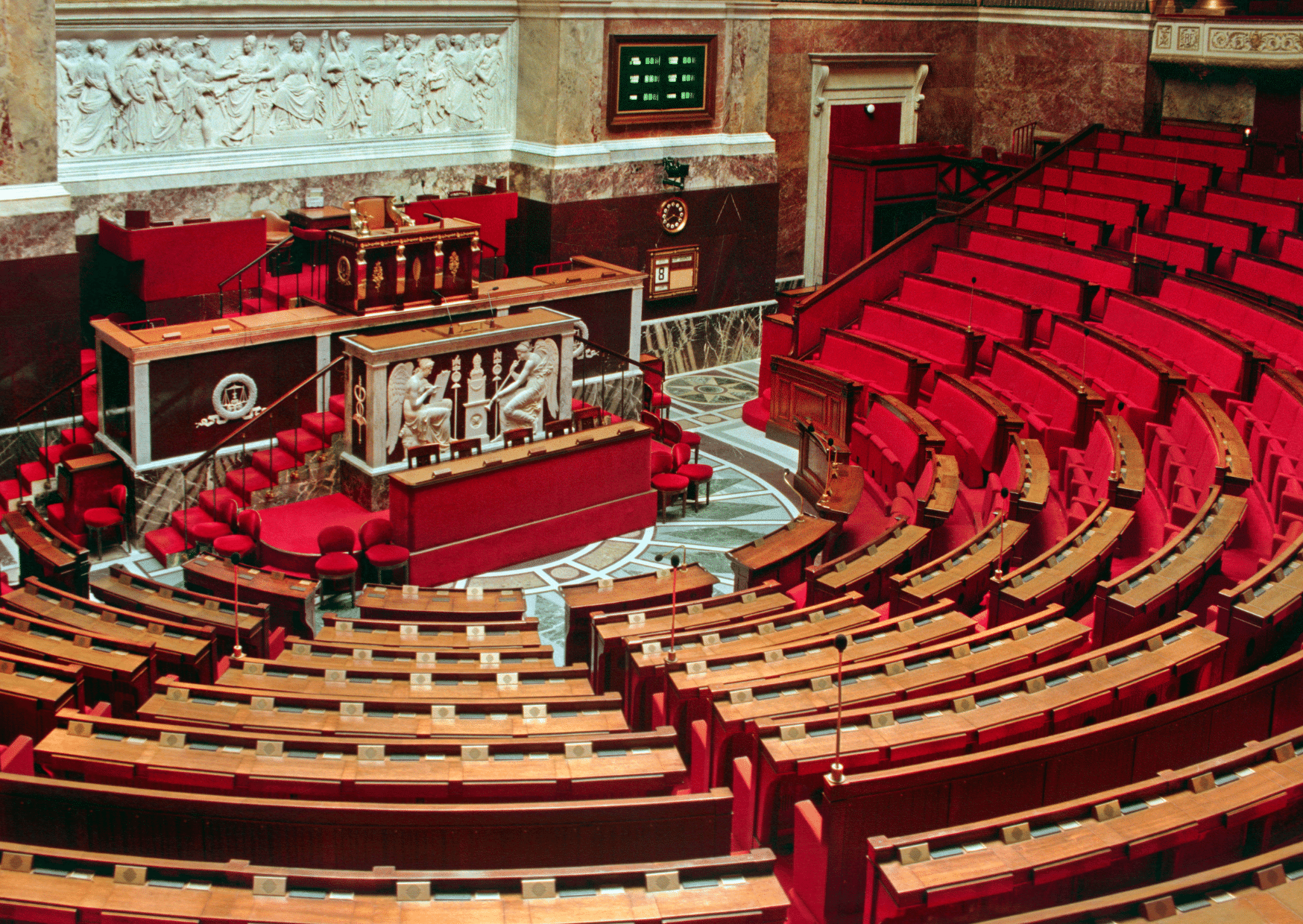Loi de bioéthique 2021 : Le diagnostic prénatal
Le diagnostic prénatal ou DPN est l’ensemble des pratiques médicales permettant de déceler les anomalies ou les malformations d’un bébé au stade fœtal ou embryonnaire. Selon l’article L2131-1 du code de la santé, « le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité. »
Le diagnostic prénatal affiche un triple objectif :
- améliorer la prise en charge médicale des enfants nés avec un problème de santé,
- préparer les parents sur les plans social et psychologique à l’arrivée de ce bébé au parcours singulier, mais aussi, parfois,
- attester la gravité de certaines pathologies afin d’engager une interruption médicale de grossesse (IMG), autorisée en France jusqu’au terme de la grossesse.
Lorsqu’une anomalie fœtale est détectée, elle doit être attestée par l’un des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN), eux-mêmes encadrés et agréés par l’Agence de la biomédecine (ABM).
I. Diagnostic et dépistage, quelle différence ?
Le diagnostic prénatal repose sur des examens d’imagerie et des dosages biologiques, mais aussi sur des examens plus invasifs (type amniocentèse). Les premiers tests effectués au cours de la grossesse sont généralement des tests de DEPISTAGE (échographie, dosages sanguins à partir d’une prise de sang de la mère), et orientent vers la nécessité ou non de réaliser un DIAGNOSTIC, en général via une amniocentèse ou un prélèvement de villosités choriales, examens qui comportent un risque non négligeable de provoquer une fausse couche (de 0,5% à 1%).
Introduit en France en 2013, le dépistage prénatal non invasif (DPNI) est une technique de dépistage prénatal, qui permet de détecter précocement des anomalies des chromosomes chez le fœtus et en particulier des formes de la trisomie 21, trisomie 13 et 18. A partir d’une simple prise de sang chez la femme enceinte, le test DPNI permet d’analyser des fragments de l’ADN du fœtus, qui circulent dans le sang maternel pendant la grossesse.
Remboursé depuis 2018, ce test est effectué par beaucoup de femmes qui ignorent qu’il n’est pas obligatoire. La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande l’intégration de l’analyse de l’ADN libre circulant dans le sang maternel du chromosome 21 lorsque le risque de trisomie 21 fœtale est estimé au regard de l’âge maternel, du dosage des marqueurs sériques (PAPP-A, ß-HCG) ou de la mesure échographique de la clarté nucale.
Selon le rapport d’activité annuel de DPN 2022 de l’ABM, le dépistage des aneuploïdies (anomalies chromosomiques), dont la trisomie 21, reste le plus fréquent selon des méthodes variées :
- Le dépistage de la trisomie 21 par les marqueurs sériques maternels (618 027 femmes testées en 2022, soit 85,5 % des naissances, contre 629 688 femmes dépistées en 2021),
- Le DPNI dont le nombre a lui augmenté par rapport à 2021, pour atteindre 129 804 en 2022
- Le diagnostic des aneuploïdies par caryotype fœtal, examen invasif qui consiste en un prélèvement pour confirmer le diagnostic de l’anomalie dépistée. Le nombre en baisse en 2022 est lié notamment à la hausse du DPNI et du diagnostic par ACPA (analyse chromosomique par puce à ADN), présenté comme plus précis qu’un caryotype.
II. Quels changements ont été apportés par la loi de bioéthique de 2021 ?
- L’extension du DPN à une enquête génétique chez les parents en cas de découvertes fortuites lors des examens habituels :
Lorsque des informations génétiques sont découvertes à l’occasion d’un test sans avoir été spécialement recherchées, elles sont utilisées dans le cadre de la « médecine fœtale », anciennement diagnostic prénatal. Selon l’article L. 2131-1, VI
« La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique […] peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 1131-1.
2. Les changements apportés par la loi de bioéthique sur l’IMG
La loi ne modifie pas substantiellement l’IMG mais y apporte tout de même des changements significatifs tant dans les conditions de fond que de forme.
- L’interruption volontaire partielle de grossesse multiple
La « réduction embryonnaire » est le terme utilisé pour décrire la pratique qui consiste à éliminer un ou plusieurs fœtus dans le cadre d’une grossesse multiple, même s’ils sont en bonne santé. La loi de bioéthique d’août 2021 précise qu’une « réduction embryonnaire » peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si elle « permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus » (art. L. 2213-1, II).
Les conditions sont plus souples qu’une IMG classique en ce que le « péril », qui est susceptible d’affecter la santé de la mère mais aussi des embryons ou des fœtus selon l’âge de la grossesse, ne doit pas nécessairement être grave.
- IMG pour les mineures non émancipées
La loi applique à l’IMG les dispositions existantes en matière d’IVG pour les femmes mineures. Même en cas de refus des parents ou d’un éventuel tuteur, une IMG peut être pratiquée sur une mineure à condition qu’elle se fasse accompagner par une personne majeure de son choix, comme pour une IVG.
- Obligation d’information du médecin en cas de refus de pratiquer une IMG
La loi de bioéthique de 2021 ajoute un article L. 2213-4 disposant qu’« un médecin qui refuse de pratiquer une IMG doit informer sans délai l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement les noms de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention ».
- Suppression du délai de réflexion
La loi supprime enfin l’obligation de proposer à la femme un délai de réflexion d’au moins une semaine avant d’interrompre sa grossesse en cas de forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
III. DPN et questions éthiques
Dans ce domaine du diagnostic prénatal, les avancées fulgurantes permettent une meilleure anticipation de l’éventuelle nécessité d’une prise en charge de l’enfant à la naissance, voire in utéro, en cours de grossesse. Néanmoins, lorsque le diagnostic d’une anomalie de l’enfant à naitre est le plus souvent suivi d’une interruption de grossesse (IMG), il y a lieu de s’interroger.
Progressivement le DPN assorti de proposition d’avortement médical s’est imposé comme une « bonne pratique » médicale. La trisomie est devenue emblématique : la France détient le record mondial du dépistage.
En cas d’anomalie chromosomique, ni traitement, ni prise en charge ne sont proposés. En 2021, 1 861 « attestations de particulière gravité » ont ainsi été délivrées après le diagnostic d’une trisomie 21. D’après le rapport de l’ABM, en 2021, 97% des femmes qui avaient reçu une attestation des CPDPN en vue d’une IMG pour motif fœtal y ont eu recours.
En 2021, le Comité pour les droits des personnes handicapées des Nations unies a reproché à la France sa politique de dépistage prénatal systématique de la trisomie 21, dévalorisant les personnes atteintes de handicap.
La technicisation de la grossesse crée un cercle vicieux dans lequel :
- le corps médical se sent comme redevable de dépister les anomalies in utero en améliorant toujours plus les outils de DPN ;
- les parents attendent beaucoup de la technique pour avoir un enfant avec le moins de défauts possibles.
Parmi les progrès attendus, notons celui de la nécessité de garantir aux futurs parents un consentement réellement libre en développant toutes les mesures nécessaires pouvant faciliter l’accueil d’un enfant pour lequel une maladie ou un handicap a été détecté, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Lors des débats de la loi bioéthique de 2021, des experts et parlementaires ont dénoncé l’eugénisme des pratiques du DPN en France. Dans un Avis rendu en 2022, le Comité consultatif national d’éthique a insisté sur la nécessité d’une « éthique de l’annonce », incluant trois critères :
- D’abord, la pluralité des options (une information a une réelle valeur éthique quand elle éclaire, sans le
sdicter, un choix qui reste ouvert sur plusieurs possibilités d’action). - Puis la neutralité (appelant à la plus grande précaution oratoire lors de l’évocation de la possibilité d’une IMG
,: « le simple fait d’envisager l’éventualité d’un arrêt de la grossesse peut produire un effet incitatif dans la mesure où, tacitement, le médecin juge la situation préoccupante »). -
Enfin, la temporalité (le temps participe aux conditions d’une réflexion non contrainte).
Conclusion
Le diagnostic prénatal devrait avoir pour seule finalité la prise en charge médicale des anomalies détectées. Toute politique en faveur du soutien des personnes handicapées et de recherche médicale ne peut aujourd’hui faire l’économie de la réflexion sur la tentation d’eugénisme qui traverse notre société.
Pour aller plus loin :
- Le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) publie un avis sur l’eugénisme. 01/03/2022
- L’eugénisme aujourd’hui – Université de la vie
- Avortement et eugénisme : les menaces contre le début de la vie. Université de la vie