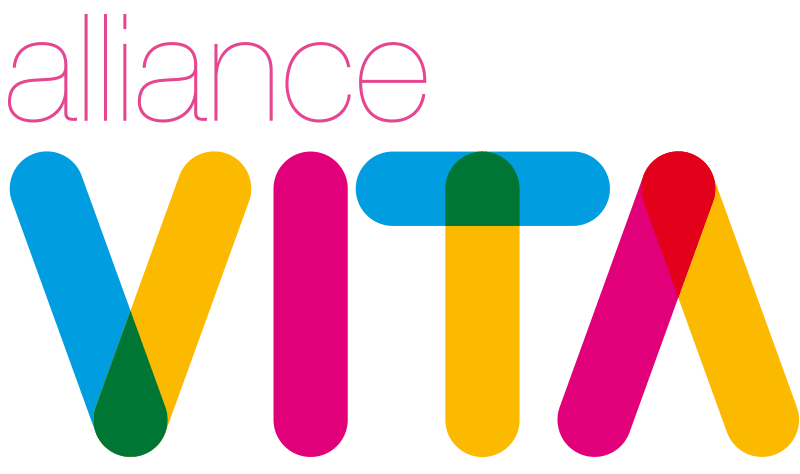Lors de cette dernière session de la phase de délibération avant la phase de restitution et d’harmonisation des travaux, les citoyens de la Convention citoyenne étaient sommés de voter à la fois sur des idées fortes sur l’accompagnement de la fin de vie et sur l’ouverture, ou non, de « l’aide active à mourir », et sous quelles modalités. Par ces votes, les citoyens se sont prononcés pour l’euthanasie et le suicide assisté. 56% des votants ont voté pour l’accès au suicide assisté pour les mineurs.
25 idées fortes pour l’accompagnement de la fin de vie
Après des travaux en groupes et une première présentation le vendredi soir, les citoyens de la Convention ont procédé, samedi soir, à un vote sur 41 propositions pour mieux accompagner la fin de vie, sur 9 thèmes différents : le développement des soins palliatifs, le respect du choix et de la volonté du patient, l’accompagnement à domicile, l’information du grand public, la formation, l’égalité d’accès à l’accompagnement de la fin de vie, l’organisation du parcours de soins de la fin de vie, les moyens dédiés à la recherche et au développement et les budgets nécessaires.
Pour que les idées fortes soumises au vote soient validées, il fallait qu’elles obtiennent deux tiers des suffrages. A l’issue du vote, ce sont finalement 25 idées fortes qui ont été retenues. Les idées fortes ayant recueilli le plus de suffrages sont les suivantes :
- Permettre une égalité d’accès aux soins palliatifs pour tous et partout sur le territoire national
- Renforcer les soins palliatifs à domicile et dans les EHPAD notamment via des équipes mobiles de soins palliatifs
- Renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé sur la fin de vie et la prise en charge palliative.
- Renforcer les campagnes d’information et de sensibilisation du grand public
- Donner les moyens humains et financiers nécessaires à l’accessibilité aux soins palliatifs pour tous, en établissement ou à domicile et sur tout le territoire.
Débats et votes sur l’ouverture de l’accès à l’aide active à mourir
Le dimanche, tous les citoyens, y compris ceux qui y sont opposés, étaient invités à débattre sur les conditions et modalités d’une éventuelle aide active à mourir. Ainsi, les citoyens devaient exposer leurs arguments pour dire si l’accès à l’aide active à mourir doit être subordonnée à un pronostic vital engagé à court, moyen ou long terme et à une maladie incurable. Ils devaient également dire si le patient doit être conscient, autonome, et majeur pour y accéder.
Durant les échanges, plusieurs citoyens, rapportant les réflexions de leurs groupes, ont soutenu qu’il fallait exclure l’idée d’un court, moyen ou long terme, prétendant qu’il est difficile de les distinguer, et ont argumenté en faveur d’une « liberté absolue » du patient. Ils ont également écarté le critère de pronostic vital, puisque seule compte à leurs yeux la souffrance.
Le critère d’incurabilité a également été écarté, toujours au nom de la souffrance et du vécu de la personne. Selon certains participants, « toutes les souffrances se valent », qu’elles soient physiques ou psychiques. Un citoyen a néanmoins regretté que le seul choix considéré fût entre souffrir et mourir. « Il me semble qu’il y a d’autres choix. »
En réponse à un citoyen qui affirmait qu’on ne devrait forcer personne à vivre, un autre a fait valoir que le désir de mourir, la pensée suicidaire peuvent être le symptôme d’une maladie psychique, comme une dépression. « L’aide active à mourir n’est-elle pas une façon radicale de soigner ces symptômes ? ». D’autres participantes ont tenté d’expliquer que les états dépressionnaires peuvent être des passages dans une vie mais qu’il existe des traitements souvent efficaces pour les soigner.
Les questions de la conscience et de l’autonomie de la personne ont également constitué une ligne de fracture au sein de la Convention, puisque certains citoyens sont favorables à ce que l’euthanasie soit accessible à des personnes qui n’ont plus leur capacité de discernement, comme les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
« Si on doit accepter la mort de tous les gens qui n’ont plus leur discernement, on va aller sur une pente extrêmement glissante qui me fait très peur ! » s’est exclamée une citoyenne en réaction.
Plusieurs participants ont mis en garde contre le risque de dérives, en s’appuyant notamment sur les exemples des Pays-Bas et du Canada. « Le problème ce n’est pas d’ouvrir une porte, mais comment on va encadrer l’ouverture de cette porte ? » s’est interrogée une citoyenne.
Sur les mineurs, plusieurs citoyens, représentant leurs groupes, ont souhaité leur ouvrir aussi l’accès à l’aide active à mourir, dans la mesure où ils peuvent être atteints des mêmes maladies que les adultes. L’un d’entre eux a même évoqué cette possibilité pour les bébés atteints de malformations.
Les débats se sont ensuite poursuivis sur les modalités de mise en œuvre de l’aide active à mourir : la formulation de la demande, les personnes impliquées, les lieux… Au cours de ces discussions, certains ont exprimé leur préférence pour le suicide assisté plutôt que pour l’euthanasie, afin de préserver les soignants et l’interdit de tuer dans la société. D’autres, à l’inverse, jugeaient que c’est le patient qui doit décider, y compris pour cette modalité.
Au terme de ces échanges, tous ont été appelés à voter sur 11 questions concernant l’évolution de la loi vers une ouverture de l’accès à une aide active à mourir.
Sur 167 citoyens présents pour ce vote,
- 75% ont voté en faveur d’une ouverture de l’accès à l’aide active à mourir (euthanasie ou suicide assisté), 19% seulement ont voté contre, 6% se sont abstenus.
- 72% se sont prononcés en faveur du suicide assisté.
- 66% se sont prononcés en faveur de l’euthanasie.
- 67% ont voté pour que l’euthanasie soit aussi ouverte aux personnes mineures et 56% pour que le suicide assisté leur soit ouvert.
A la question « La possibilité d’un accès à l’aide active à mourir sous la forme du suicide assisté devrait-elle être ouverte aux personnes réunissant les conditions … ? » ,
- 20% ont répondu « atteintes de maladies incurables provoquant des souffrances ou douleurs réfractaires ET dont le pronostic vital est engagé à court terme ou moyen terme » ;
- 45% ont répondu « atteintes de maladies incurables provoquant des souffrances ou douleurs réfractaires sans pronostic vital nécessairement engagé ;
- 35% se sont abstenus.
A la question « La possibilité d’un accès à l’aide active à mourir sous la forme de l’euthanasie devrait-elle être ouverte seulement aux personnes capables d’exprimer une volonté libre et éclairée ? », 37% ont répondu « oui », 35% ont voté « non », 28% se sont abstenus.
L’ensemble des résultats des votes est accessible sur le site de la Convention citoyenne.
Ainsi, malgré les arguments de risques de dérives, en particulier pour les personnes les plus fragiles de la société, et les alertes des soignants auditionnés lors des précédentes sessions, de nombreux membres de la Convention semblent ne pas avoir pris en considération les conséquences de leurs votes. S’ils sont pris au mot par l’exécutif, ces votes pourraient faire prendre un virage dramatique à notre modèle de société. Les citoyens de la Convention en ont-ils conscience ? Ont-ils conscience des conséquences gravissimes d’une autorisation d’une aide active à mourir sur la prévention du suicide, a fortiori si le suicide assisté est ouvert aux jeunes mineurs ou aux personnes dépressives sans pronostic vital engagé ? Au-delà de l’effroi qu’ils inspirent, ces votes démontrent combien cet exercice peut s’éloigner de la réalité humaine.
![[CP] L’avortement, otage de manœuvres politiciennes](https://www.alliancevita.org/wp-content/uploads/2023/03/Avortement-dans-la-constitution-ivg-projet-de-loi-1080x675.jpg)