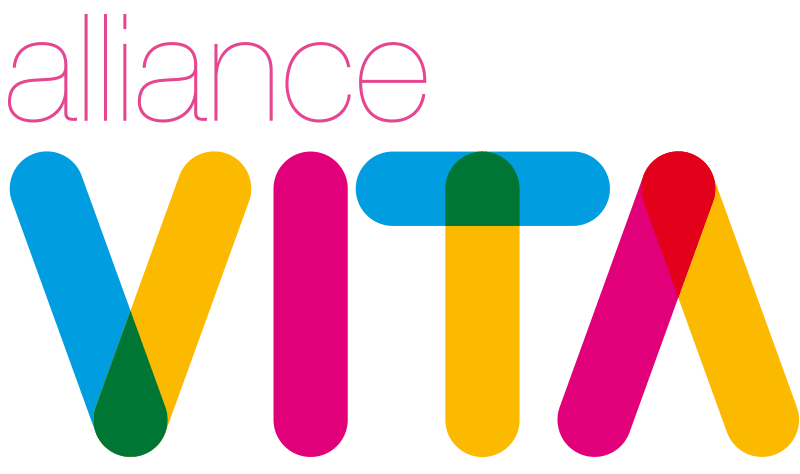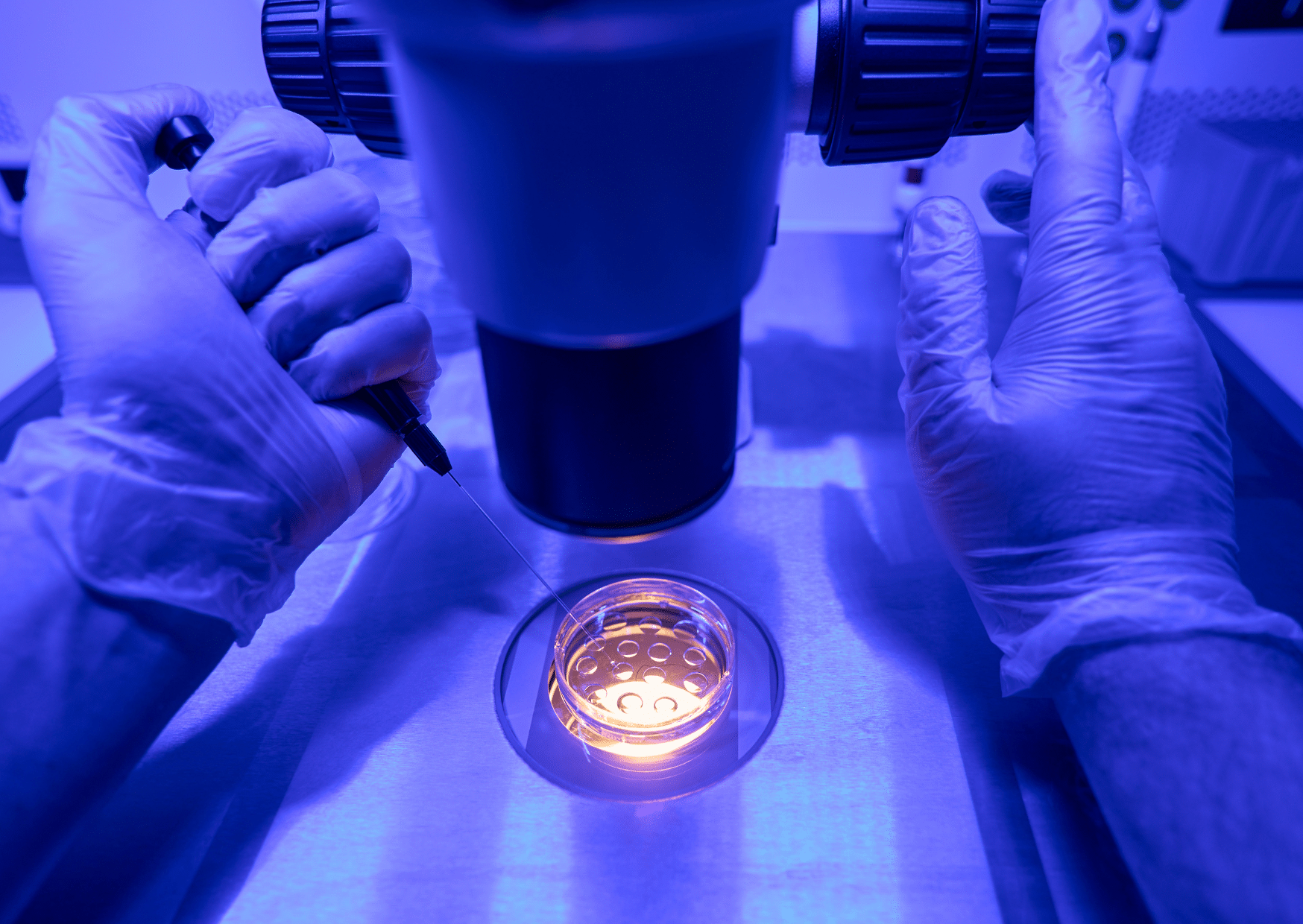La lutte contre la maltraitance des personnes âgées, une priorité qui doit être assortie de moyens concrets
La Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées le 15 juin est l’occasion d’évoquer les situations de maltraitance de plus en plus fréquentes envers les personnes âgées. Si le Gouvernement semble prendre au sérieux cette question à travers la publication récente de sa Stratégie nationale de lutte contre les maltraitances, les professionnels du secteur alertent sur l’origine systémique de ces maltraitances, dans un contexte d’insuffisance de moyens et de pénuries massives de personnel aussi bien dans les établissements que dans le secteur de l’aide à domicile. Un rapport récent de l’IGAS montre que cette situation risque de s’aggraver encore dans les prochaines années.
Dans son rapport sur l’année 2023, le 3977, le numéro national pour signaler une situation de maltraitance envers une personne âgée en France, signale l’ouverture de 6 300 dossiers pour « situation préoccupante » sur 16 900 appels décrochés. Ce chiffre est en augmentation de 16 % par rapport à 2022. Néanmoins, le rapport évoque une « sous-déclaration massive des maltraitances » et précise que « la fréquence des maltraitances n’est pas connue en France ». Selon le rapport, « les victimes le sont pour quasi moitié, de leur entourage familial » (45 %). « La maltraitance en institution ou dans le cadre du soin ou de l’accompagnement social représente tout cumulé 34,5 % des mis en cause. »
Le 24 mars dernier, une enquête diffusée par le magazine « Zone interdite » de M6, intitulée « Scandales et défaillance de l’État : les dossiers noirs du handicap », a levé le voile sur les nombreux cas de maltraitances sur des personnes en situation de handicap dans certains établissements. En réaction, Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des Personnes âgées et des Personnes handicapées avait annoncé « un grand plan de contrôle de tous les 9 300 établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap ». En parallèle, le Gouvernement a publié sa Stratégie nationale de lutte contre les maltraitances pour la période 2024-2027.
Dans ce document d’une vingtaine de pages, le Gouvernement dévoile une série de mesures pour lutter contre les maltraitances autour de trois axes : faire respecter les droits des personnes, se doter de meilleurs outils pour recueillir, suivre et répondre aux situations de maltraitance dans les territoires, et renforcer la vigilance. En préambule, le rapport indique que, à la suite de l’affaire Orpéa, plus de la moitié des 7 500 EHPAD de France ont fait l’objet d’un contrôle et qu’ils auront tous été contrôlés d’ici la fin de l’année 2024.
Cette « stratégie nationale » s’article avec la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. Cette loi contient un volet de lutte et de prévention contre les maltraitances. Parmi les principales mesures, cette loi institue dans chaque département une « cellule de recueil et de traitement des alertes » en cas de maltraitance de personnes âgées ou handicapées vulnérables.
Placée auprès de l’ARS, cette cellule sera chargée du recueil des signalements et de leur transmission aux autorités compétentes. Parmi les autres mesures contenues dans la loi « Bien-vieillir », un droit de visite est reconnu pour les personnes hébergées en établissements de santé ou en EHPAD. La loi contient aussi de nombreuses dispositions sur les EHPAD, notamment pour développer l’information des usagers et des familles sur la qualité de la prise en charge des résidents et pour renforcer leur contrôle.
Malgré ces efforts, dans un communiqué du 4 juin 2024, l’Association des Directeurs au service des Personnes Agées (AD-PA) alerte sur « l’origine systémique » des maltraitances envers les personnes âgées : « La principale cause des maltraitances systémiques est l’incurie des pouvoirs publics qui n’ont depuis jamais engagé les réformes structurelles préconisées par l’ensemble de ses propres rapports. Pire, l’Etat annonce fièrement renforcer sa politique de contrôles afin de renvoyer les responsabilités qui sont les siennes dans le camp de professionnels épuisés. »
L’association demande des moyens supplémentaires, notamment un meilleur ratio d’encadrement dans les EHPAD et une réévaluation de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa).
Cette alerte de l’AD-PA rejoint les constats de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) dans un rapport alarmant publié le 29 mars 2024. La mission a constaté « des situations de grande tension, où la saturation des établissements et la fragilité des services à domicile pouvaient conduire à maintenir des personnes chez elles dans des situations dégradées, et à reporter la charge sur le système hospitalier et les familles. »
Selon le rapport, « faute d’une action publique ambitieuse tant sur le financement que sur les moyens humains à mobiliser, des conséquences nombreuses et diverses sont à craindre : dégradation des conditions de vie et d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie, saturation des Ehpad, report de charge vers les familles, pénibilité accrue des métiers du grand âge, développement de modes de prise en charge peu encadrés pour des personnes vulnérables (ex. emploi direct), risques de maltraitance à domicile comme en établissement… ».
Aujourd’hui, le secteur de l’aide à domicile fait face à des pénuries importantes de personnel. Selon Franck Nataf, président de la Fédération française de services à la personne et de proximité (Fedesap), il manquerait 60 000 salariés à l’ensemble du secteur. Et pour cause, les métiers de l’aide à domicile font face à un déficit d’attractivité. Selon un rapport de France Stratégie, les aides à domicile seraient parmi les métiers « les moins favorisés parmi l’ensemble des familles professionnelles ».
Le rapport relève des proportions de CDD et temps partiels importantes, avec « un revenu salarial annuel net de 11 233 euros, soit 9 000 euros de moins que la moyenne des salariés ».
Comme le relève le rapport de l’IGAS, le secteur de l’aide à domicile se trouve dans une situation de « sous-financement structurel ». Ces dernières années, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui finance l’aide à domicile, a été revalorisée mais cela reste insuffisant pour les professionnels du secteur. Le tarif minimal de l’heure s’élève aujourd’hui à 23,50 € tandis que les employeurs estiment le coût de revient d’une heure à 32 €.
Et la situation pourrait encore s’aggraver dans les années à venir avec l’augmentation du nombre de personnes âgées en situation de perte d’autonomie, qui seront près de 4 millions en 2050. Les besoins d’aide et d’accompagnement à domicile devraient augmenter de 20 % d’ici à 10 ans et de 60 % d’ici 30 ans. Dans son rapport, l’IGAS identifie plusieurs facteurs de risques :
- La diminution du nombre de proches aidants potentiels due notamment à la hausse de la déconjugalisation et à la baisse du nombre d’enfants,
- L’intensification des difficultés de recrutement de l’aide à domicile avec la raréfaction de la population active,
- La fragilité des projections budgétaires de l’administration,
- La place ambiguë des résidences et habitats inclusifs.
Malgré ces alertes, le Gouvernement n’a jamais présenté sa grande loi sur le grand âge et l’autonomie, pourtant annoncée par le Président Emmanuel Macron dès 2018 et promise par la Première Ministre Elisabeth Borne en novembre 2023. Inscrite dans la loi sur le « Bien vieillir » du 8 avril 2024, une loi de programmation du grand âge devait être adoptée d’ici la fin de l’année 2024.
La ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités Catherine Vautrin avait déclaré en janvier avoir saisi le Conseil d’Etat à ce sujet en raison d’une difficulté constitutionnelle sur ce projet de loi. Or, lors des débats sur le projet de loi sur la fin de vie fin mai, la ministre a indiqué aux députés que la saisine n’avait jamais été transmise au Conseil d’Etat. Cette révélation a provoqué la colère des professionnels du secteur.
Dans un communiqué, la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa) s’est déclarée choquée par cette annonce. « Alors même que les déficits des établissements et services pour personnes âgées s’aggravent, que les tensions en ressources humaines sont quasi structurelles, que notre pays vieillit et doit se préparer à accompagner un nombre croissant de personnes âgées, la FNADEPA regrette cet écran de fumée et appelle le Gouvernement à respecter ses engagements. »
Quoi qu’il arrive, et malgré le niveau élevé de la dette, le prochain gouvernement ne pourra surseoir à s’attaquer à la question du financement et de la prise en charge globale du grand âge, sous peine de voir s’aggraver encore les maltraitances envers les personnes vulnérables. Cette question devra être une priorité nationale.