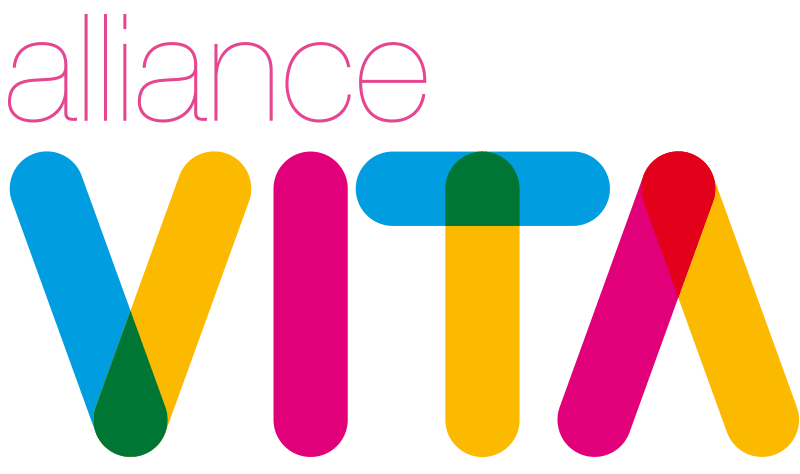par Claire Anne Brule | décembre 22, 2021 | Aidant et Accompagnement

Le midazolam, médicament recommandé en première intention pour la sédation, n’était à présent disponible qu’en milieu hospitalier. Il peut désormais être prescrit par les médecins généralistes, depuis l’arrêté paru le 17 décembre au Journal Officiel, dans le but d’améliorer la prise en charge des patients en fin de vie à leur domicile.
La demande d’extension d’indication du midazolam en ville a été faite par la Haute autorité de santé dans un communiqué de presse le 10 février 2020. Peu de temps avant, dans une lettre au Syndicat des Médecins Libéraux, Agnès Buzyn alors ministre de la Santé, assimilait le midazolam à la sédation profonde et continue. Cette confusion accentuait le risque d’occulter la réelle utilité de cette molécule sédative pour l’orienter vers une pratique « banalisée » de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, sédation qui doit rester exceptionnelle et encadrée par les recommandations de la HAS mises à jour en janvier 2020.
Les inquiétudes suscitées par cet arrêté
Le journal La Croix rapporte des réactions de professionnels des soins palliatifs. Le Dr Jean-Marie Gomas, médecin de soins palliatifs, souligne les atouts du midazolam, « sa rapidité d’action, qui le rend très souple et très maniable ». Mais cette rapidité a aussi un inconvénient qui appelle à une grande vigilance : « Mal dosé ou surdosé, le midazolam peut tuer – et non plus seulement endormir – en quelques heures ». C’est ce qui inquiète Marion Broucke, infirmière en soins palliatifs. « L’Hypnovel (nom commercial du midazolam) demande une adaptation continue, une évaluation heure par heure. Les médecins généralistes ne sont pas tous bien formés à ce type de médicaments. J’ai peur qu’il y ait des drames. » avoue-t-elle. « D’autant qu’en milieu hospitalier, les sédations se décident après une réflexion collégiale. À domicile, comment le médecin va-t-il acter la procédure ? On est face à un défi énorme de formation. »
De son côté le Dr Olivier Mermet, médecin généraliste et membre du comité de pilotage du plan soins palliatifs pour 2021-2024, souligne les difficultés organisationnelles que présente la prescription du midazolam par les médecins généralistes : « La difficulté n’est pas tant médicamenteuse qu’organisationnelle. Ce qui est complexe, c’est tout l’environnement à mettre en place autour d’une pratique sédative à domicile ou en établissement. Dans certains cas, comme pour une sédation profonde et continue jusqu’au décès, la démarche collégiale est obligatoire. Il faut déjà pouvoir l’organiser. Sans oublier qu’il faut absolument prévoir un lit de repli s’il y a un problème. »
Des recommandations particulières
La Haute Autorité de Santé, consciente de l’enjeu de formation pour permettre l’administration du midazolam en tout lieu de soins, y compris au domicile, a rappelé ses conditions de prescription en publiant en novembre 2021 des recommandations particulières. Elle a notamment précisé la différence entre les sédations proportionnées, c’est-à-dire de profondeur et de durée proportionnelles au soulagement du symptôme et les sédations profondes et continues provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès (SPCMD). Pour ces dernières, la réalisation à domicile nécessite systématiquement l’appui d’une équipe spécialisée en soins palliatifs : « L’équipe qui prend en charge le patient doit s’appuyer sur les structures disponibles disposant d’une équipe ayant les compétences en soins palliatifs (notamment les réseaux, les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) extrahospitalières et/ou d’hospitalisation à domicile (HAD) lorsque le patient est à domicile). En leur absence, elle doit prendre contact avec une équipe spécialisée en soins palliatifs pour avoir un médecin référent, compétent en soins palliatifs, prévenu et joignable pour des conseils pharmacologiques. Un médecin et une infirmier(ère) doivent être joignables 24 h/24, l’infirmier(ère) devant pouvoir se déplacer. »
Lors d’une prescription de midazolam pour une sédation en soins palliatifs, l’équipe soignante à domicile doit être accompagnée, selon les recommandations de la HAS, par une équipe de soins palliatifs et d’hospitalisation à domicile, impliquant une organisation en réseau de soins adaptée.
Si ces conditions ne sont pas réunies, une prise en charge hospitalière doit être privilégiée.
Pour aller plus loin : Midazolam et fin de vie à domicile : sortir de la confusion

par Claire Anne Brule | décembre 3, 2021 | Législation en France, Suicide assisté et euthanasie

La chaine Public Sénat, a diffusé le samedi 27 novembre à 21h le documentaire d’Antoine Laura de 2018 intitulé « J’ai décidé de mourir » militant en faveur de l’euthanasie. Avec ses quatre invités tous favorables à l’euthanasie et au suicide assisté, le prétendu débat qui a suivi, visait en réalité à justifier l’euthanasie.
Le réalisateur du documentaire a suivi Anne Bert en 2017 durant les six derniers mois de sa vie : atteinte de la maladie de Charcot, elle « a fait le choix de l’euthanasie en Belgique, où elle s’est éteinte digne, sereine, mais malheureusement loin de sa Charente-Maritime » selon les mots du réalisateur du documentaire qui s’est lié d’amitié avec la protagoniste.
Quatre personnes étaient invitées pour un débat dans l’émission « Un monde en docs » qui a suivi la diffusion du film. Chacun a exprimé son avis personnel en faveur de l’euthanasie et du suicide assisté, niant le caractère militant du documentaire. Ils se sont bornés à analyser les résistances à l’évolution de la législation sur la fin de vie en France.
Les spécialistes interrogés sont :
- Odon Vallet, historien des religions, professeur émérite des Universités. Après avoir stigmatisé la maladie de Charcot (« C’est affreux, il n’y a pas pire que cette maladie »), celui-ci rappelle l’étymologie du mot euthanasie et en conclut que « les évêques français se trompent, ce n’est pas anti-chrétien. »
- Daniel Borrillo, juriste, spécialiste des questions bioéthiques, auteur du livre « Disposer de son corps, un droit encore à conquérir », met en avant le courage d’Anne Bert et l’épreuve qui a été la sienne du fait de devoir partir en Belgique pour mourir. Selon lui la loi Leonetti-Claeys de 2016 a été « contreproductive : elle a retenu la main des médecins qui ont toujours peur que quelque chose puisse leur être reproché.»
- Véronique Fournier, cardiologue, ancienne présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, auteur de « Histoires de vie, histoires de mort : itinéraire d’une réflexion », entretient la confusion en exprimant que « le médecin peut ne pas être pour l’euthanasie et accompagner le patient au plus près de son désir [de mourir] ». Elle propose de « franchir le faire mourir » en levant l’interdit de tuer par l’euthanasie pour que « les médecins n’aient plus peur du judiciaire. »
- Catherine Deroche, sénatrice LR de Maine-et-Loire, présidente de la commission des affaires sociales du Sénat, avait voté contre la proposition de loi n° 131 visant à établir le droit à mourir dans la dignité, lors de son examen en commission le 3 mars 2021. Elle avait alors rappelé que « La dignité d’un homme est préservée jusqu’à son dernier souffle, malgré la déchéance physique que je ne peux me résoudre à considérer comme indigne. » Dans l’émission de Public Sénat, celle-ci reste très consensuelle : elle ne nie pas les témoignages de la brutalité du suicide assisté et affirme cependant qu’ « on se doit de respecter ce que la personne choisit pour elle-même » en suggérant que le suicide assisté en Oregon est une « liberté choisie qui peut inspirer certaines solutions » pour la France.
Le collectif Soulager mais pas tuer, qui rassemble des professionnels et usagers de la santé opposés à toute forme d’euthanasie et de suicide assisté, a dénoncé dans un tweet ce faux débat : « Comment @publicsenat peut inviter 4 personnes favorables à l’#Euthanasie et au #SuicideAssisté et affirmer que le documentaire sur la fin de vie d’Anne Bert euthanasiée en Belgique en 2017 n’est pas militant ? #propagande #UMED @fitouss #FindeVie ».

par Claire Anne Brule | novembre 18, 2021 | Aidant et Accompagnement, handicap

La sclérose latérale amyotrophique (SLA), plus connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative incurable qui entraîne une paralysie progressive des muscles, affectant la respiration, la parole et la déglutition. Sa durée de vie médiane est de 36 mois, son incidence annuelle de 1600 cas. Un groupe de travail du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) s’est attaché à étudier les conditions de fin de vie des personnes atteintes de SLA pour analyser l’adéquation entre la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 et les besoins et demandes de ces patients.
L’organisation de la prise en charge de la SLA est définie par trois « plans nationaux maladies rares » successifs (2005-2008 ; 2011-2016, 2018-2022) qui ont conduit à la création de 19 centres SLA et autres maladies du neurone moteur. Les données du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) montrent que sur l’année 2018, 1031 patients atteints de SLA sont décédés à l’hôpital dont 69 % en services de médecine, 23 % en hospitalisation à domicile, 9 % en service de soins de suite et réadaptation avec des durées moyennes de séjours respectives de 12, 74 et 73 jours. Parmi les patients atteints de SLA décédés à l’hôpital, 8 % sont décédés en Unité de soins palliatifs (USP), 8 % en Lits identifiés de soins palliatifs (LISP) et 13 % en service de réanimation. L’insuffisance respiratoire est la première cause de décès provoqué par la SLA. L’hospitalisation en fin de vie peut être justifiée par une situation clinique critique qui ne peut être prise en charge à domicile ou être secondaire à l’épuisement des proches.
Dans la synthèse publiée le 2 novembre 2021 le groupe de travail s’interroge sur le faible pourcentage de décès en unité de soins palliatifs comparé notamment aux prises en charge en réanimation. Il questionne aussi le nombre des patients porteurs d’une trachéotomie, plus élevé en 2016 qu’en 2008 (8 % contre 3 %). Historiquement indiquée dans les situations d’urgences asphyxiques non anticipées, son utilisation devrait être plus rare depuis le développement des techniques de ventilation non invasives (VNI).
Ces chiffres sur les décès des patients atteints de SLA ouvrent des questionnements importants à approfondir pour mieux comprendre les parcours des patients. Par exemple, d’où viennent les patients qui décèdent en service de médecine ? Une part d’entre eux étaient-ils pris en charge en hospitalisation à domicile (HAD) ? Certains étaient-ils à domicile sans HAD ou dans d’autres services de médecine ? Doit-on faire l’hypothèse qu’il y a des variations liées aux lieux de prise en charge ou à l’âge des patients ? Ces questions nécessiteront des études et recherches complémentaires. Les témoignages recueillis par le groupe de travail révèlent qu’au-delà des parcours de soins hétérogènes, la complexité de la fin de vie est commune à trois situations marquées par une décompensation respiratoire ayant justifié une hospitalisation dans le dernier mois de vie. La prise en charge à domicile sous-tendue par un maillage médical et paramédical dense semble être plus satisfaisante mais elle ne peut répondre à toutes les situations.
Fin de vie et SLA : une prise en charge médicale paradoxale ?
« La particularité de la SLA c’est que plus on avance vers la fin de vie, plus on médicalise la prise en charge. C’est un paradoxe pour les équipes mais aussi pour les patients, dans ce qui se joue psychiquement : il n’y a plus rien à faire et on parle de palliatif mais en même temps on apporte tout ce matériel », indique Camille Brodziak, infirmière en centre expert SLA et membre du groupe de travail du CNSPFV.
Les patients interrogés dans l’enquête IFOP commanditée par l’ARSLA dont les résultats ont été publiés au printemps 2020, expriment une lucidité face à une mort inéluctable. Ils sont préoccupés des conditions de leur fin de vie et trouvent peu d’espaces de dialogue avec les professionnels de santé notamment ceux qui vont les prendre en charge en phase terminale.
Les ambiguïtés de la Loi Claeys-Leonetti
Les échanges au sein du groupe de travail ont montré que deux visions s’opposaient :
– d’un côté, celle d’un certain nombre de soignants qui estiment que la sédation profonde et continue jusqu’au décès est une pratique clinique ultime, mobilisable lorsque tout autre thérapeutique a été tentée, sans succès ;
– de l’autre, des patients, des proches et certains médecins et soignants qui comprennent la sédation profonde et continue jusqu’au décès comme un droit auquel ils peuvent accéder lorsque leur décision d’arrêt des traitements est prise.
Une question émerge : qui est légitime pour décider de la mise en place d’une sédation profonde et continue ? La loi entretient une certaine ambiguïté sur ce point : d’un côté, elle dit que le patient peut accéder à la SPCJD sous certaines conditions, de l’autre, elle soumet cet accès à une décision médicale.
Les situations de souffrance existentielle sont le motif de plus en plus de demandes de sédation profonde et continue jusqu’au décès de patients atteints de SLA. Là encore, la question de leur légitimité s’est posée au groupe. Pour certains, ces demandes sont le reflet d’une société prônant la performance et n’accordant aucune place au handicap ou à tout type de contre-performance. Le regard porté par la société, par les proches sur la personne malade ne pourrait-il être la cause de cette souffrance existentielle ? D’autres estiment que cette souffrance n’est pas la résultante d’une image dégradée dans les yeux des autres mais l’expression que la personne malade, en pleine conscience, ne veut plus vivre dans les conditions qui sont devenues celles de son quotidien et ne souhaite pas vivre les ultimes dégradations imposées par la maladie.
La sédation profonde et continue jusqu’au décès s’intègre dans un processus qui va inéluctablement conduire à la mort et engage fortement la responsabilité médicale. Elle introduit une forme de ritualisation, difficile à vivre pour les soignants. Le Dr Richard, médecin en Unité de soins palliatifs, témoigne : « lorsque la demande est acceptée et programmée, le patient peut – et souvent – met en place un dernier repas avec sa famille, il fait ses adieux ; il organise les relations et les évènements qui précèdent son endormissement. Cela est perçu comme une ritualisation de la préparation à la mort qui ressemble à ce qui est rapporté des euthanasies en Belgique, aux Pays-Bas ou dans d’autres pays ayant dépénalisé la pratique. Cette certitude de la mort qui s’annonce trouble les équipes de soins palliatifs. On imagine que lorsque l’on retire le masque, ça va s’arrêter tout de suite mais il n’est pas rare que le patient ventile encore. Pour les proches c’est difficile. Comment gérer ce temps suspendu ? Comment s’occuper du patient et de ses proches ? Comment combler l’attente de la mort ? Comment accepter cette coupure volontaire de toute communication, sciemment induite par la SPCJD ? »
Les praticiens de soins palliatifs du groupe de travail ont souligné la difficulté pour leurs équipes et eux-mêmes – et pas seulement pour les proches – de ces questionnements qui reflètent un paradoxe : la certitude de la mort puisque la sédation en place sera maintenue jusqu’au décès mais l’incertitude concernant la survenue de la mort puisqu’il ne s’agit ni de la retenir ni de la hâter.
Une autre ambiguïté induite par la loi Claeys-Leonetti est celle de la temporalité de la fin de vie.
La loi ne définit pas le pronostic engagé à court terme, auquel elle articule la possibilité de sédation profonde et continue jusqu’au décès. Les médecins du groupe ont compris cette temporalité de fin de vie comme étant très courte, dans le droit fil des recommandations de la HAS, actualisées en 2020, définissant le court terme de quelques heures à quelques jours. Cela signifie que la SPCJD ne peut remplir sa mission d’accompagnement de fin de vie que chez des personnes affaiblies, dégradées physiologiquement et pour lesquelles le pronostic vital est donc engagé à court terme.
Accompagner : informer, anticiper, coordonner
En matière d’organisation, le groupe de travail du CNSPFV relève une inadéquation entre les besoins spécifiques de la fin de vie en cas de SLA et les critères médico-économiques. Cet écart entraîne des dysfonctionnements dans la prise en charge. De plus, l’accompagnement de fin de vie à domicile pour les patients qui le souhaitent peut être limité par la charge intense qui pèse sur les proches/aidants et l’inégalité territoriale d’accès aux réseaux de soins. À ce constat s’ajoute les difficultés d’accès aux unités de soins palliatifs en cas de SLA.
“Le scénario idéal est celui de l’information et de l’anticipation des épisodes évolutifs de la maladie. La coordination entre les services de neurologie et de soins palliatifs devrait permettre un accompagnement gradué du patient à tous les stades de sa maladie“, résume le CNSPFV. Quant à la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, il convient qu’elle soit, dans tous les cas, en adéquation avec les dispositions légales : “L’objectif primaire est bien de soulager les souffrances du patient mais pas d’accélérer intentionnellement la survenue du décès“. D’où la nécessité de développer « des unités où les conditions d’exercice garantiront l’essentiel de la qualité de l’accompagnement aux patients atteints de SLA en fin de vie ».

par Claire Anne Brule | novembre 17, 2021 | Maternité et paternité

La prématurité, c’est le fait de venir au monde avant huit mois de grossesse. Nés entre 24 et 26 semaines d’aménorrhée révolues, les enfants sont considérés comme extrêmes prématurés. Entre 27 et 31 semaines, comme grands prématurés. Entre 32 et 34 semaines, comme modérément prématurés.
Les chiffres permettent de réaliser l’importance du sujet : en France, un bébé naît prématurément toutes les 8 minutes. 165 bébés par jour. 60 000 par an. 8% des naissances. Aujourd’hui, grâce aux progrès médicaux, des bébés entièrement privés du dernier trimestre de grossesse peuvent être sauvés.
Malgré tout, en France, la prématurité est la première cause de mortalité néo natale et est responsable de la moitié des handicaps d’origine périnatale.
En 2021, la revue The British Medical Journal publiait l’enquête EPIPAGE-2, pilotée par l’INSERM et incluant au départ 5170 enfants nés prématurément entre avril et décembre 2011. Le suivi de ces enfants s’est déroulé sur plusieurs années et dans 25 régions. Les chercheurs se sont intéressés à leur devenir, à leur insertion scolaire, à leur recours à des prises en charge, ainsi qu’aux inquiétudes ressenties par leurs parents. L’objectif était de mieux comprendre les conséquences de la prématurité pour les enfants, plus précisément sur leur devenir neuro-moteur, sensoriel, cognitif, comportemental ainsi que pour leurs apprentissages.
Les résultats de l’enquête montrent qu’à l’âge de 5 ans et demi, 35% des enfants nés extrêmes prématurés, près de 45% des grands prématurés et 55% de ceux nés modérément prématurés auront une trajectoire développementale proche de la normale. L’étude révèle que quel que soit le degré de prématurité à la naissance, plus d’un tiers des enfants présentaient des difficultés dites mineures. Elle révèle aussi que plus la prématurité est grande, plus les enfants présentent de difficultés du neuro-développement et plus la scolarité de l’enfant nécessite d’être adaptée. Alors que 93% des enfants modérément prématurés étaient scolarisés dans des classes ordinaires (sans soutien spécifique), cette part ne concernait plus que 73% des enfants nés extrêmes prématurés. Plus de la moitié des enfants nés extrêmement prématurés bénéficiaient d’une prise en charge de soutien au développement (orthophonie, psychomotricité, ou encore soutien psychologique, etc.) ainsi qu’un tiers des enfants nés grands prématurés et un quart de ceux nés modérément prématurés. Néanmoins, 20 à 40% des enfants avec des difficultés sévères n’avait pas de soutien. La première partie de cette enquête publiée en 2017, également via The British Medical Journal montrait que depuis 20 ans les enfants nés prématurément vivent mieux et ont moins de séquelles.
Grace au travail de l’association SOS Préma depuis 15 ans, les droits des familles ont progressé. Le congé maternité a pu être augmenté. Cette mesure, à l’initiative de SOS Préma, permet à toute maman de ne reprendre son travail qu’à la date à laquelle elle aurait dû le reprendre si elle avait accouché à terme. Même progrès pour favoriser la présence du père auprès de la mère et de l’enfant. Après des années de travail, l’association a obtenu l’allongement du congé de paternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né.