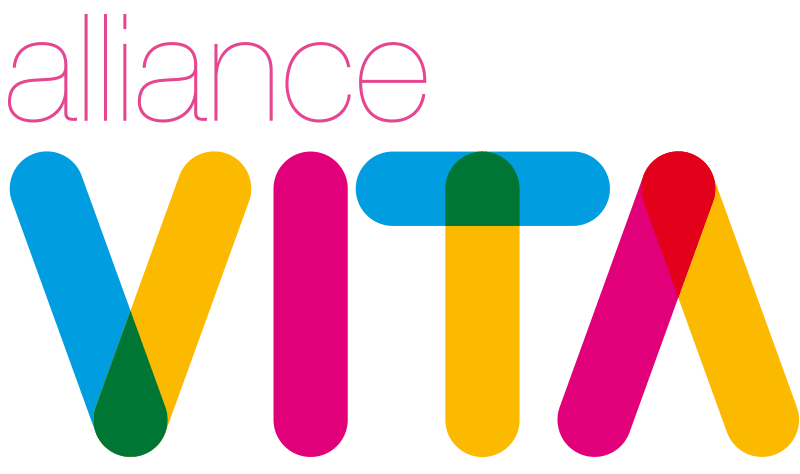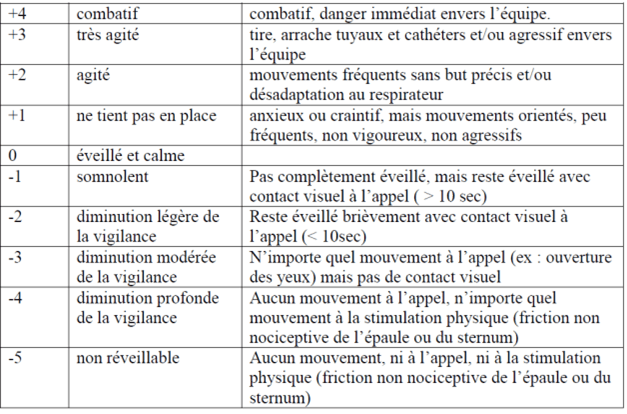Avortement en Espagne : des cliniques privées condamnées pour publicité mensongère par le Tribunal Suprême
Le Tribunal Suprême espagnol a confirmé en septembre dernier un jugement du Tribunal d’Oviedo condamnant l’ACAI pour publicité mensongère. L’ACAI (Asociacion de Clinicas Acreditadas para la Interrupcion Voluntaria del Embarazo) est un groupement d’une trentaine de cliniques privées, accréditées pour pratiquer des avortements.
Une affirmation générale trompeuse
Avant ce jugement, sur son site et dans une rubrique dédiée aux questions fréquentes, à la question “de quels risques puis-je souffrir si je pratique un avortement?” la réponse informait que “L’interruption de grossesse est une opération qui ne laisse pas de séquelles, donc quand vous tombez enceinte, ce sera comme si vous n’aviez pas eu d’avortement précédent. Il n’y a pas non plus de risque de stérilité de subir un ou plusieurs avortements. L’avortement est l’intervention chirurgicale la plus fréquente en Espagne qui ne laisse pas de séquelles et l’incidence des complications est très faible“. Un groupe d’avocats avait attaqué l’ACAI sur l’affirmation de l’absence de séquelle, affirmation de portée générale. Le Tribunal d’Oviedo, dans son jugement confirmé par le Tribunal Suprême, a retenu l’appellation de publicité mensongère suite à différents témoignages apportés devant le tribunal au sujet de possibles séquelles. Un gynécologue, une chirurgienne et une thérapeute ont ainsi été entendus, leur témoignage portant sur l’existence de cas où des séquelles, en particulier psychologiques, avaient été observées.
Suite au jugement, le site web de l’ACAI a modifié la réponse à la question de la façon suivante : “L’avortement est l’une des interventions instrumentales les plus fréquentes en Espagne, son incidence de complications est faible lorsqu’il est effectué par des professionnels formés pour effectuer cette intervention et lorsqu’un accompagnement psychologique correct a été effectué. Les professionnels des centres vous informeront au cours du processus des complications possibles et / ou des effets secondaires de l’intervention, et il sera enregistré que cela a été le cas en signant un consentement éclairé.“
L’avortement en Espagne : une situation différente de la France
L’avortement en Espagne est régi par une loi de 2010 qui autorise l’avortement jusqu’à la quatorzième semaine de grossesse, et la vingt-deuxième “en cas de risque grave pour la vie ou la santé de la femme enceinte ou risque d’anomalies graves pour le fœtus”. Le gouvernement espagnol a présenté en mai dernier un projet de loi pour éliminer le délai de réflexion de 3 jours et l’obligation du consentement parental pour les mineures, une clause qui avait été réintroduite dans une loi datant de 2015. Les chiffres les plus récents publiés par les autorités font état de 88269 avortements en Espagne en 2021, soit un taux de recours à 10.3 pour 1000 femmes âgées de 15 à 44 ans. Ce taux est à 15.5 en France selon les dernières statistiques publiées. Par ailleurs, 15% des avortements sont opérés dans des hôpitaux publics, le reste se faisant dans des cliniques privées. Les statistiques en répertorient environ 200 sur le territoire espagnol.
Cette décision juridique à l’encontre de certaines cliniques rappelle l’importance de ne pas occulter les réalités vécues par des femmes au profit d’une approche à la fois idéologique et commerciale.
Banaliser la pratique et les conséquences de l’avortement pour des femmes ne peut être un objectif de santé publique.