
Nouvelles naissances par FIV 3 parents, les dessous d’une étude
Nouvelles naissances par FIV 3 parents, les dessous d’une étude
Une étude publiée le 16 juillet 2025 dans le New England Journal of Medicine annonce les nouvelles naissances de plusieurs enfants conçus par une technique de procréation artificielle avec « don de mitochondries ». Cette technique est déjà connue sous le nom de « FIV 3 parents », car elle implique la création d’embryons humains à partir des gamètes de 3 personnes, deux femmes et un homme. À l’occasion de la publication de ces expériences menées en Grande Bretagne, cette technique a été fréquemment présentée comme « une avancée » ou une « expérience sans précédent » En réalité, la FIV 3 parents n’est pas récente, et reste très controversée dans le monde scientifique, pour des raisons éthiques et surtout, sanitaires. Ce point est peu évoqué, pourtant elle fait de chaque enfant le propre cobaye de cette manipulation à l’origine de sa vie. Il est important de rappeler que le « don de mitochondries » ne soigne personne, et n’empêche pas des bébés d’être « sauvés » de certaines maladies, comme on peut le lire dans la presse. En réalité, elle « créée » de toutes pièces de nouvelles personnes, dont le génome mitochondrial a été modifié, dans l’espoir d’éviter une maladie, mais en faisant d’elles des sujets d’expérimentation, en l’absence de tout consentement préalable possible.
Par ailleurs, l’étude confirme que le « don de mitochondries » n’empêche pas la transmission de mitochondries mutantes. La technique n’est ni sûre, ni efficace. Elle démontre également l’important taux d’échecs, et donc de fausses promesses faites aux parents, ainsi que l’immense quantité d’ovocytes mais aussi et surtout d’embryons humains (plusieurs centaines) « consommés » pour aboutir à la naissance de quelques enfants vivants, pour lesquels les éléments concernant leur santé future restent insuffisants pour être rassurants. Notamment, car ils sont encore très jeunes et qu’il n’y a pas de recul.
La promotion de ces techniques de manipulation des embryons humains et leur mise en œuvre concrète révèlent une vision inquiétante de la procréation humaine : assumer qu’une volonté de transmettre ses gènes à tout prix à un enfant puisse conduire à créer des bébés sur mesure, quel qu’en soit le prix à payer pour lui ou pour les générations futures. Ces modifications génétiques seront héréditaires, si les petites filles ainsi nées deviennent elles-mêmes mères. Cet enjeu majeur n’est même pas évoqué dans l’étude. Quelles peuvent être ces conséquences ? Nul ne peut y répondre avec certitude aujourd’hui. On joue avec la vie.
Pourquoi parle-t-on désormais de « don de mitochondrie » ?
Cette dénomination est utilisée à dessein, même si elle est plus compliquée (pour ne pas dire incompréhensible pour le plus grand nombre) que FIV 3 parents. Cette dénomination rassure par son côté scientifique, tout est étant connoté positivement (par la présence du mot « don »).
Les mitochondries sont bien le cœur du sujet. Ce sont des petits corpuscules (organites) que l’on trouve dans presque toutes nos cellules, dans des proportions variables. Ce sont des petites « usines à énergie » qui produisent un « carburant » vital grâce à un système intégré très élaboré appelé « chaîne respiratoire ». Essentielles au bon fonctionnement des cellules et de l’organisme, les mitochondries ont aussi une particularité notable et fondamentale: elles possèdent leur propre ADN, dit ADN mitochondrial (ADNmt). Confiné à l’intérieur des mitochondries, ce génome est distinct de l’ADN contenu dans les chromosomes, mais représente néanmoins 1 % de l’ADN total d’une cellule. Chaque cellule d’un être humain contient donc deux génomes: le génome nucléaire (chromosomes, contenus dans le noyau) qui compte 22 000 gènes environ. Et le petit génome mitochondrial qui compte 37 gènes.
Ainsi, bien qu’elle ait son propre ADN, la mitochondrie ne fonctionne donc pas « en autonomie ». Les pièces qui constituent la mitochondrie, en particulier autour de la chaîne respiratoire, sont mises en place par une double commande, venant à la fois de l’ADNmt et de l’ADN nucléaire (à 98 %). Ainsi, la plupart des protéines nécessaires au fonctionnement de la mitochondrie sont produites dans le corps de la cellule, sous commandement de l’ADN nucléaire.
Qu’est-ce qu’une maladie mitochondriale ?
Si l’ADN ou l’ADNmt porte une anomalie, une mutation par exemple, le fonctionnement de la mitochondrie peut être altéré. Et si les mitochondries sont défectueuses, cela peut déclencher des maladies rares, mais parfois très graves, qu’on appelle « maladies mitochondriales », touchant toutes les tranches d’âge avec des symptômes extrêmement variés. Une personne peut donc être touchée par une maladie mitochondriale dont les causes sont dues à des mutations, héréditaires ou spontanées, de l’ADNmt ou de l’ADN. Il existe plus de 300 types connus de maladie mitochondriale. Les phénomènes liés au vieillissement peuvent aussi conduire au dysfonctionnement mitochondrial, au fur et à mesure des années.
Par ailleurs, dans ces maladies, il existe plusieurs cas de figure. Il faut savoir qu’au sein des cellules d’une personne porteuse d’une mutation peuvent coexister des mitochondries saines et d’autres mutantes. On appelle cela « l’hétéroplasmie ». Dans ce cas, un « niveau seuil » peut être requis en dessous duquel les symptômes de la maladie n’apparaissent pas. Ce seuil peut varier d’un type de mutation à un autre, d’un tissu à l’autre et d’un malade à l’autre. En dessous de ce seuil, une personne peut donc être porteuse sans être malade. Une femme qui serait dans ce cas de figure développera alors dans ses ovaires différents types d’ovocytes qui pourront être peu, pas du tout ou très « chargés » en mitochondries malades. Et selon la « charge initiale », ses enfants peuvent être porteurs sains, dans une « zone grise », ou malheureusement malades et présenter des symptômes.
Au contraire, on parle d’homoplasmie lorsque toutes les molécules d’ADN mitochondrial (ADNmt) portent une mutation ou lorsqu’elles sont toutes normales.
En quoi consiste cette technique de procréation artificielle ?
Elle consiste en la création d’embryon humain in vitro, à partir de 2 ovocytes et un spermatozoïde. La technique est promue dans deux situations : l’éviction d’une maladie mitochondriale liée à l’ADNmt d’un côté, un prétendu « rajeunissement des ovocytes » de l’autre. Dans l’étude publiée récemment, c’est le premier cas qui est concerné.
Ces manipulations consistent, pour faire simple, à « déplacer » le matériel génétique (noyau) maternel d’un ovocyte d’une femme dans l’ovocyte d’une autre femme, avant d’induire la fécondation par un spermatozoïde. Ou bien, et c’est le cas dans l’étude en question, à déplacer le matériel génétique maternel et paternel d’un ovocyte à un autre, juste après la fécondation. Puis, pour les embryons qui survivent et se développent, on procède à leur implantation dans l’utérus.
Par des micromanipulations, le matériel génétique de la donneuse est retiré de son ovocyte. Deux techniques, détaillées plus loin, sont possibles pour remplacer le matériel génétique de l’ovocyte (D) de la donneuse par celui (M) de la femme souhaitant être mère, ou directement par le matériel génétique complet issu de la fécondation de l’ovocyte (M) avec le spermatozoïde de l’homme concerné (conjoint ou donneur).
Quand ces techniques ont commencé à émerger, on les nommait « FIV 3 parents », non seulement car elles impliquent que 3 personnes soient parties prenantes, mais aussi, car l’embryon ainsi conçu contient l’ADN de ces 3 personnes distinctes (l’ADN nucléaire du père et de la mère, et l’ADN mitochondrial de l’autre femme).
Par ailleurs, la technique implique pour chacune des femmes, celles qui souhaitent être mères génétiques comme celles qui seront donneuses d’ovocytes[1], de recourir à une stimulation ovarienne et au prélèvement chirurgical dans leurs ovaires, sous anesthésie générale. Une procédure qui n’est pas sans risque et pas toujours suivie de succès. Les ovules prélevés seront ensuite vitrifiés pour être conservés.
L’étude ici détaille que pour les 25 femmes donneuses impliquées, 38 procédures de stimulation ovarienne / prélèvement ont été réalisées, ce qui a abouti à la récolte de 736 ovocytes. Pour les femmes désirant être mères, quelle que soit la méthode utilisée par la suite, sur les 71 incluses, seules 53 ont été éligibles pour le prélèvement. Elles ont subi un à trois cycles de stimulation ovarienne / prélèvement pour aboutir à un « stock » suffisant d’ovocytes. L’étude rapporte que 1245 ovocytes ont ainsi été récoltés.
La technique implique aussi, nous le verrons, la création d’une très grande quantité d’embryons.
Comment se transmettent les mitochondries aux générations futures ?
Les mitochondries sont transmises par la mère, au moment de la fécondation, puisque c’est l’ovocyte maternel (plus grosse cellule du corps féminin) qui sert de première cellule au nouvel être humain (zygote), lorsqu’il y a eu fécondation. Après la fécondation, seules les mitochondries apportées par la mère sont présentes dans l’embryon et lui servent de « réserve » initiale, dont il a besoin pour vivre et se développer.
Les mitochondries sont également nombreuses dans le spermatozoïde, en particulier dans la pièce intermédiaire qui relie sa tête et son flagelle, car il a besoin d’énergie pour se mouvoir. Mais dans le cas d’une fécondation naturelle, la plupart des organites apportés par le spermatozoïde, et notamment ses mitochondries, ne sont pas transmis à la descendance, car ils sont en quelque sorte « digérés » par la partie externe de l’ovocyte juste après la fécondation. Seul le noyau dans la tête du spermatozoïde, qui porte l’information génétique du père, pénètre dans le corps de l’ovocyte.
Comment se déroule un « don de mitochondries » ?
C’est plus complexe que ne le laisse entendre l’intitulé euphémisant de « don de mitochondries ». Il ne s’agit pas d’un simple prélèvement dans une cellule, avant une injection à un embryon in vitro, comme on ferait un « simple » don du sang.
Nous sommes ici dans des situations où une femme risque de transmettre une maladie à ses enfants. Ce risque est connu, soit parce qu’elle-même présente des symptômes et qu’un diagnostic est déjà posé, soit parce qu’elle a déjà mis au monde un enfant porteur d’une telle anomalie. Bien sûr, la seule cause de maladie mitochondriale à laquelle la « FIV-3 parents » prétend répondre est celle où la mère est porteuse de mitochondries dont l’ADNmt est anormal. Cette technique serait inopérante dans le cas où l’anomalie de fonctionnement des mitochondries serait liée à une mutation portée par un chromosome (ADN nucléaire).
La technique entend alors concevoir un enfant dont la cellule initiale, le zygote, serait le plus possible exempt de mitochondries malades. Pour cela, on utilise des ovocytes de donneuses non affectées par la maladie. Leurs mitochondries sont donc saines, fonctionnelles, et possèdent un ADNmt normal.
L’objectif de la méthode est d’abord d’énucléer (retirer le noyau, le matériel génétique) des ovocytes de donneuses puis d’y introduire l’autre patrimoine génétique, celui de la femme ou du couple qui souhaite avoir un enfant. On appelle cela un « transfert nucléaire ». Ces infimes manipulations sont réalisées à l’aide de micropipettes, sous microscope.
Deux méthodes sont possibles :
- En pré-fécondation : transfert du fuseau maternel
Seul le matériel génétique (fuseau maternel en métaphase II présent dans l’ovocyte) de la femme qui souhaite être mère est transféré dans l’ovocyte de la donneuse. On se situe donc là avant la fécondation. Une fois que cet « échange » a eu lieu, la fécondation de l’ovocyte est provoquée par ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïdes) qui revient à forcer l’introduction d’un spermatozoïde à l’intérieur de l’ovocyte.
- En post fécondation : transfert pronucléaire
C’est cette méthode qui a été privilégiée dans l’étude dont il est question.
Ici, on met en place une double fécondation, pour créer deux types de zygotes en parallèle. Les premiers zygotes sont issus des ovocytes (M) de la femme qui souhaite être mère, fécondés par ICSI par des spermatozoïdes de son conjoint ou d’un donneur.
Les seconds, créées en parallèle, le sont à partir de la fécondation d’ovocytes (D) d’une donneuse sélectionnée, également par ICSI, avec des spermatozoïdes du même homme.
Suite à cela, pendant le laps de temps (quelques heures) où le matériel génétique paternel et maternel (pronoyaux) migrent l’un vers l’autre (pour « fusionner » et donner l’ADN complet de l’individu nouvellement conçu), on vient aspirer par micropipette ces deux pronoyaux de l’ovocyte.
Ceux présents dans les zygotes issus de la donneuse sont jetés.
Après une brève exposition à un agent de fusion (enveloppe de virus hémagglutinant du japon, précise l’étude) les deux pronoyaux prélevés dans les zygotes issus de la patiente sont transférés dans les zygotes de la donneuse, (auxquels on a donc au préalable retiré les deux pronoyaux)
Ainsi, on crée en parallèle deux types d’embryons pour chaque couple concerné : ceux issus du futur père (ou d’un donneur) et de la future mère, et en même temps d’autres issus du même père et des ovocytes d’une donneuse.
Mais attention : quelle que soit la méthode utilisée, le transfert concomitant de mitochondries maternelles anormales depuis l’ovocyte maternel jusqu’à l’ovocyte de donneuse est inévitable, étant donné leur présence autour des noyaux et les tailles microscopiques (de l’ordre du µm) de ces organites et des cellules dont on parle.
Il est donc impossible de transférer des noyaux d’un ovocyte à un autre sans transférer en même temps du cytoplasme (contenu d’une cellule) et donc des mitochondries.
Qu’annonce l’étude ?
Cette étude annonce la naissance de plusieurs enfants, issus de la technique de transfert des pronoyaux en post fécondation, mais également, en parallèle, la naissance d’enfants issus d’une autre, plus simple.
1ère méthode : FIV 3 parents, transfert en post fécondation
32 femmes patientes ont été admises dans l’étude. Puis seules 25 d’entre elles ont été retenues comme éligibles pour tenter la phase de stimulation ovarienne/prélèvement d’ovocytes. On a pu en récolter pour 22 d’entre elles. Parmi les ovocytes récoltés, 487 ovocytes du groupe des 22 femmes incluses dans la FIV 3 parents ont été vitrifiés et stockés.
Par la suite, on a réalisé une ICSI sur 357 ovocytes avec un spermatozoïde du conjoint (pour 21 femmes) ou d’un donneur (pour une femme). Un donneur a été requis dans un cas étant donné que la donneuse d’ovocyte retenue était génétiquement reliée au partenaire masculin de la patiente…
Sur les 22 femmes qui ont pu fournir des ovocytes, une fécondation par ICSI a été déclenchée sur leurs ovocytes. Pour 19 d’entre elles, le protocole de FIV 3 parents a continué en utilisant la technique de transfert pronucléaire dans les ovocytes de donneuses.
Dans le même temps, les ovocytes de 25 femmes donneuses ont été fécondés par ICSI, avec les mêmes pourvoyeurs de sperme. Au total, 572 ovules de donneurs et d’ovules correspondants de patientes ont été injectés avec des spermatozoïdes provenant de la même source.
Ensuite, pour ces 19 femmes concernées, des tentatives de transfert pronucléaire ont été mises en place sur 160 paires de zygotes. Soit 320 embryons, aux tous premiers stades de leur développement.
L’étude précise que « le remplacement des pronoyaux du zygote du donneur par les pronoyaux du zygote du patient a été couronné de succès dans 127 des 160 tentatives (79,4 %). Sur les 127 embryons issus de ces tentatives réussies, 122 (96,1 %) étaient intacts le lendemain ». Ces zygotes ont secondairement subi des tests pour quantifier le taux de cytoplasme passé d’un zygote à l’autre. Mais, étonnement, la réglementation du Royaume-Uni n’autorise pas le dosage de l’hétéroplasmie dans les embryons obtenus par transfert pronucléaire (HFEA Code of Practice, section 33, édition 9.4, octobre 2023).
Les embryons de 18 femmes ont survécu à ces manipulations et ont été retenus comme acceptables pour être congelés ou implantés dans leur utérus.
Tout cela a conduit à 8 grossesses sur 22 femmes au départ, (soit 36%) (une était encore en cours au moment de la publication). Aucune des femmes porteuses de certains variant de mutation ne sont tombées enceintes.
Aucune des patientes enceintes du groupe n’avait opté pour un diagnostic prénatal.
Ces grossesses ont abouti à la naissance de 8 bébés vivants. Après la naissance, des examens ont été réalisés.
Chez 5 des 8 bébés, le niveau d’hétéroplasmie était indétectable (inférieur à 3%). 3 présentaient des taux allant de 5 à 16%. Ces taux sont donc faibles, ce qui est rassurant.
2ème méthode : FIV « classique » sans donneuse suivie d’un DPI (diagnostic préimplantatoire)
Il a été proposé à 39 autres femmes, atteintes d’hétéroplasmie, d’avoir recours à un autre procédé. Pour elles, on a procédé à des fécondations in vitro « classiques », avec leurs propres ovocytes non manipulés, et donc sans recourir à des ovocytes de donneuses. A l’issue des FIV et après 3 jours de développement, les embryons qui ont survécu ont été testés par une technique de diagnostic préimplantatoire, pour évaluer le taux d’ADNmt mutant présent dans les mitochondries. Pour ce type d’examen, on prélève une cellule (un blastomère) de l’embryon en éprouvette et on en mesure la charge d’ADNmt mutant. A noter que ce prélèvement, aléatoire, donne une « photo » à un instant donné du taux d’ADNmt mutant d’une cellule, non représentative de l’embryon complet ou de l’enfant en devenir, étant donné la condition d’hétéroplasmie et l’évolution possible de son taux. Les blastomères chargés à moins de 30% en ADNmt maternel malade ont été utilisés pour l’implantation dans l’utérus des potentielles futures mères impliquées dans les protocoles.
Pour 31 femmes sur les 39, des embryons ont pu être congelés et réimplantés dans leur utérus. Une grossesse clinique a été confirmé pour 16 des 39 (soit 41%) femmes, 3 s’étant au préalable terminées en fausses couches. 18 bébés sont nés vivants.
L’un des enfants a présenté une anomalie cardiaque. Les autres semblent en bonne santé, mais la plupart des parents (11 sur 18) n’ont pas acceptés que des tests d’hétéroplasmie soient réalisés sur leurs bébés…
Questions éthiques et sanitaires
Il subsiste tant d’inconnues
Comme nous l’avons vu, la mitochondrie ne fonctionne pas en autonomie à partir du seul ADNmt. Une majorité des composants de la mitochondrie sont même produits grâce à l’ADN nucléaire. Les interactions entre les deux ADN sont majeures, on dit qu’ils « dialoguent ». Cette donnée essentielle met en lumière qu’interchanger un ovocyte par celui d’une donneuse n’est pas neutre. L’hypothèse que ce soit la raison pour laquelle les mitochondries mutantes aient parfois le dernier mot en décimant les mitochondries saines, pourtant plus nombreuses au départ, n’est pas à exclure.
Comment dialoguent l’ADNmt des mitochondries de la donneuse avec l’ADN nucléaire de la mère génétique, avec quelles conséquences lorsqu’ils ne sont pas issus du même patrimoine génétique ? Il y a là de nombreuses inconnues sur ce qui va se jouer dans l’entièreté des cellules du corps humain de ces enfants créées par ces méthodes.
Quelle sécurité pour la santé des enfants nés, à long terme ?
Finalement, quelle que soit la méthode utilisée (transfert pronucléaire ou diagnostic préimplantatoire), les informations données sur la santé des nouveau-nés sont très faibles et n’évoquent que pour certains d’entre les taux d’hétéroplasmie relevés à la naissance. Leur évolution ou leur stabilité n’est pas étudiée ou mentionnée.
Les auteurs en conviennent eux-mêmes : « Étant donné le potentiel d’amplification de la petite fraction d’ADNmt maternel qui est co-transférée avec le génome nucléaire, le suivi des résultats sera essentiel pour déterminer si l’hétéroplasmie reste stable dans le temps et dans les différents types de tissus ». La question est : est-ce que ces faibles taux dont se félicitent les auteurs resteront stables, ou est-ce que l’évolution du nombre de mitochondries mutantes pourrait, à un moment donné, conduire à dépasser le seul critique de déclenchement des symptômes et de la maladie ? Nul ne le sait à ce jour…
Quelle que soit la méthode utilisée, Il est impossible de transférer des noyaux sans transférer en même temps quelques mitochondries. Or, nous savons que les mitochondries maternelles peuvent se multiplier et même venir jusqu’à remplacer celles de la donneuse. Comme le révèle l’étude qui cite d’autres publications antérieures « pour des raisons qui restent obscures, la petite quantité d’ADNmt maternel augmente jusqu’à des niveaux homoplasmiques dans environ 20 % des lignées de cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons obtenus après une procédure de don mitochondrial ». Ce qu’il faut donc comprendre dans ce cas-là, c’est qu’on est face à un échec total de la procédure. La technique projette de limiter la présence de mitochondries mutantes, au sein d’un ensemble de mitochondries saines. Mais les mutantes, qu’on ne peut éliminer totalement, viennent, petit à petit, dans certains cas, remplacer les saines.
Ainsi, pour deux bébés nés sur les 8 nés après transfert pronucléaire, les auteurs ne s’expliquent pas pourquoi leurs taux étaient de 12 et 16%, ce qui est très élevé. Ils écrivent : « parmi les explications possibles, on peut citer un avantage réplicatif de l’ADNmt de la patiente par rapport à l’ADNmt de la donneuse d’ovules ou une distribution inégale de l’hétéroplasmie induite par le don de mitochondries qui entraînerait un enrichissement dans un sous-ensemble de cellules embryonnaires qui ségrégent ensuite dans la lignée de l’épiblaste ». Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que l’ADNmt de la donneuse serait moins capable de se répliquer, il serait comme désavantagé par rapport à celui de la mère. Est-ce lié au dialogue ADNmt / ADN nucléaire déjà évoqué ? Nul ne le sait. Par ailleurs, selon l’endroit où les pronoyaux sont déposés dans le zygote, les mitochondries mutantes se répartiraient en proportions différentes dans les cellules embryonnaires dans la suite du développement et des divisions cellulaires, et au cours de ce développement embryonnaire, certaines lignées cellulaires pourraient se retrouver « très chargés » ou au contraire « peu chargés » en ADNmt maternel.
Bref. Le devenir des mitochondries mutantes au sein de l’embryon puis du nouvel enfant est immaîtrisable, aussi bien pour leur localisation que pour leur nombre et leur évolution numérique.
Cela interroge sur la santé à long terme des enfants nés de ces techniques, dont finalement, ils sont les cobayes… à vie.
Et la donneuse dans tout ça ?
Les questions éthiques qui se posent sur cette pratique sont nombreuses et vertigineuses. Pour la première fois, on aboutit à la création d’un enfant à partir de l’ADN de trois personnes, par l’intervention d’une « contributrice génétique supplémentaire ». C’est une rupture dans le processus naturel de la procréation humaine.
Il serait malhonnête intellectuellement de considérer ce rôle de « contributrice génétique » comme secondaire ou minime, attendu que c’est précisément ce rôle qui a « justifié » toute la mise en place de cette procédure.
Par ailleurs, considérer l’ovocyte maternel comme un simple « sac à main » interchangeable entre la mère génétique d’un enfant et une autre femme n’est pas sérieux. La science n’a de cesse de découvrir la particularité de cette cellule et la « contribution maternelle » unique qu’elle joue dans les premiers jours de la vie embryonnaire. La FIV-3 parents balaye ce qui peut s’avérer absolument essentiel dans la construction embryonnaire et la santé future de l’enfant. Loin d’être anodine, la contribution maternelle des premiers jours est évincée, et pourtant, les ARNm présents dans le zygote de la mère biologique ont été fabriqués grâce au génome maternel, Ce sont les ARNm fournis par la mère qui sont la source de la fabrication des protéines essentielles à l’embryon aux premiers stades de son développement. Dans le cas de la FIV 3 parents, ce sont les ARNm de la donneuse qui devront interagir avec un génome embryonnaire avec lequel ils n’ont rien à voir.
Enfin, n’oublions pas que derrière ces expérimentations se tapit aussi le marché de la procréation artificielle et de l’infertilité liée à l’âge, véritable face cachée de la FIV 3 parents. Nombre des publications citées en bibliographie de l’étude attestent du lien entre ces deux usages possibles. Celui de l’infertilité étant bien plus vaste.
Pour aller plus loin
La Fécondation In Vitro à 3 parents : défi ou délire biologique ? 03/02/2015
Bébés sur mesure – le monde des meilleurs – Blanche STREB avril 2018
[1] En Grande Bretagne, les donneuses d’ovocytes reçoivent en compensation minimum 985 livres (environ 1180 euros) par cycles.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
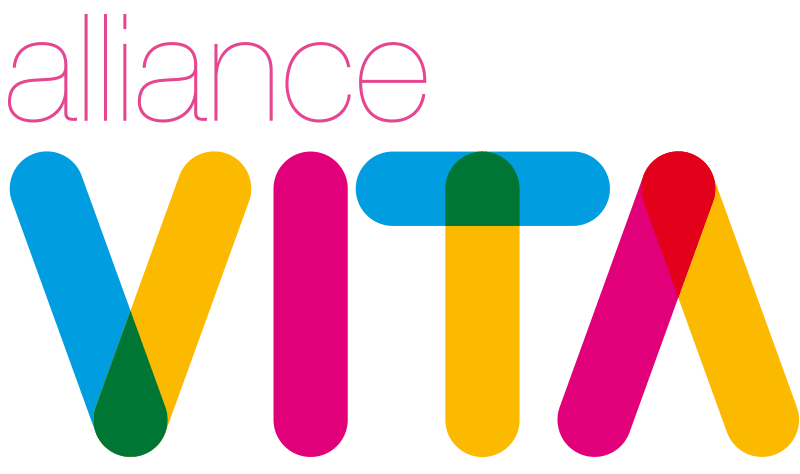









![[CP] – Besoin de soin, pas d’euthanasie](https://www.alliancevita.org/wp-content/uploads/2025/07/We-need-care-not-euthanasia-1080x675.jpg)




