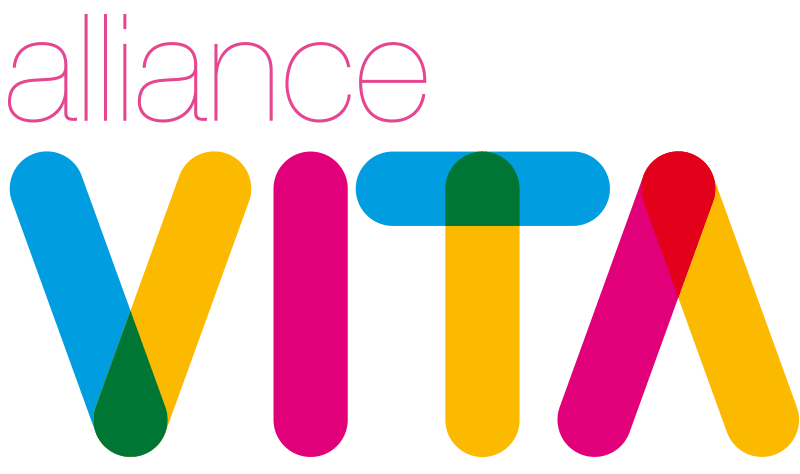Priorité à l'humanité
Replacer l’humanité au centre de toutes les politiques publiques devrait être le fondement d’un projet présidentiel respectueux des valeurs fondamentales de la France, pays des droits de l’Homme.Législatives 2024 : nos urgences
La situation politique instable n’en rend que plus prioritaire l’engagement constant d’Alliance VITA, solidaire des plus fragiles. C’est pourquoi l’association défend devant tous les candidats et tous les partis, 5 voies prioritaires pour la vie.
1.
Développer la solidarité
intergénérationnelle
2.
Favoriser un écosystème pour la famille durable
3.
Soutenir les innovations garantes de la protection des plus fragiles

Ce qu’en pensent
les candidats
1.
Développer la solidarité
intergénérationnelle
La pandémie de Covid-19 a jeté une lumière crue sur la situation des plus vulnérables dans notre société : confinement sévère pour les personnes âgées, grande pauvreté jusqu’à la privation de nourriture pour les familles les plus précaires et à faibles revenus, fermeture des écoles et des cantines scolaires, solitude accrue et, pour tous, difficultés à gérer les injonctions et émotions contradictoires liées à la situation.
Le vieillissement progressif de la population, lié à l’accroissement considérable de l’espérance de vie, a des conséquences majeures sur les grands équilibres économiques (ex : financement de la dépendance), mais aussi culturels (ex : solitude croissante des personnes très âgées, fins de vie qui « durent longtemps », notamment avec des maladies graves type Alzheimer…).
Maintes fois annoncée, et tout aussi fréquemment repoussée, cette loi est plus que jamais nécessaire comme la crise du COVID-19 est venue nous le rappeler.
La société française de 2050, dans laquelle près de 5 millions de Français auront plus de 85 ans et dans laquelle le nombre d’aînés en perte d’autonomie aura presque doublé, se construit aujourd’hui. C’est donc aujourd’hui qu’il nous faut agir, pour intégrer enfin le risque de la perte d’autonomie des personnes âgées dans la structure même de nos politiques sociales.
Cela inclut notamment le statut des aidants en partie soutenu ces dernières années qui devrait être renforcé.
Cet effort commun pour accompagner le grand âge et la dépendance devrait également être accompagné d’un élan de solidarité intergénérationnelle. Signal fort de renforcement de la cohésion sociale, une plateforme nationale pour faire connaître et partager les bonnes pratiques permettrait de multiplier les initiatives intergénérationnelles.
Chaque année, plus de 9 000 hommes et femmes mettent fin à leurs jours dans notre pays et 200 000 font une tentative de suicide. « Le grand public voit cela comme une fatalité : si quelqu’un veut se tuer, il y arrivera. En réalité, on peut toujours agir. Les études montrent que, si on tend la main à ceux en difficulté, si on les accompagne, ils ne se suicident pas » constate le Pr. Philippe Courtet, chef de service de psychiatrie au CHU de Montpellier[1]. Le Quotidien du Médecin[2] rapportait le 5 février 2022, journée de prévention du suicide, les premiers résultats du numéro national 3114 de prévention du suicide, qui a reçu 34 000 appels depuis son ouverture le 1er octobre 2021.
Entre 10 et 15 % des appels vers le 3114 ont débouché sur une prise en charge du Samu, précise le ministère. « Chaque jour, nous constatons encore davantage à quel point ce numéro unique est utile, et à quel point il est un pilier majeur de notre lutte contre le suicide et en faveur de la santé mentale de nos concitoyens », a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ce dispositif s’ajoute au dispositif VigilanS, créé en 2015 et déployé dans 17 régions dont 4 d’Outre-mer (l’objectif restant une couverture territoriale nationale, avec un dispositif par région) ou encore Papageno, pour éviter toute contagion suicidaire.
Environ 3 000 personnes âgées se suicident chaque année, soit près d’un tiers des suicides en France. Le taux de suicide le plus élevé se constate chez les plus de 85 ans.
Mieux lutter contre l’isolement et le suicide des personnes âgées est absolument indispensable. 1,2 million de personnes âgées de plus de 75 ans sont en situation d’isolement relationnel, et ce phénomène ne fait que s’aggraver ces dernières années, d’après l’Observatoire national de la fin de vie. C’est une forme de mort sociale ». La dépression concerne 40% des personnes âgées en institution et constitue le principal facteur de risque de suicide.
[1] L’Express, 7 octobre 2021, p. 65
[2] https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/journee-de-prevention-du-suicide-le-numero-national-3114-sollicite-plus-de-30-000-fois-depuis-son
Une inquiétude croissante a été exprimée au niveau de l’ONU concernant les conséquences des législations sur le suicide assisté et l’euthanasie dans la population.
Dans une déclaration commune publiée le 25 janvier 2021, trois experts internationaux de l’ONU alertent sur le chemin emprunté par plusieurs pays vers la légalisation de l’euthanasie pour les personnes handicapées. : « Le handicap ne devrait jamais être une raison pour mettre fin à une vie ». Le Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées, le Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les Droits de l’homme, ainsi que l’expert indépendant sur les droits des personnes âgées insistent sur le fait que « l’aide médicale au suicide » – ou l’euthanasie –, même lorsqu’elle est limitée aux personnes en fin de vie ou en maladie terminale, peut conduire les personnes handicapées ou âgées à vouloir mettre fin à leur vie prématurément.
Selon le sondage IFOP[1] Les Français et la fin de vie, réalisé en mars 2021, parmi leurs deux priorités concernant leur propre fin de vie, un peu plus d’un Français sur deux (55%) cite une réponse en lien avec l’accompagnement, dont 38% le fait d’être accompagné par des proches. Ils sont également une petite moitié à mentionner comme priorité le fait de ne pas subir de douleur (48%) et ne pas faire l’objet d’un acharnement thérapeutique (46%) tandis que pouvoir obtenir l’euthanasie n’est cité que par un quart d’entre eux (24%).
[1] https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-la-fin-de-vie-3/
L’idée, avancée, selon laquelle « On ne meurt pas bien en France », est souvent, entendue, lors d’interventions dans des colloques, d’interviews dans les media ou de tribunes dans les journaux. Au point de laisser accroire que, loin d’améliorer les choses, les lois successives auraient conduit à une détérioration de la situation dans notre pays.
Or, comment peut-on se contenter d’une telle affirmation sans la moindre démonstration ?
Dans ces conditions, et alors que certains demandent déjà une nouvelle loi sur la fin de vie, il conviendrait de mieux appréhender comment les Français meurent : isolés ou entourés ? A leur domicile ou en institution ? Avec ou sans souffrance ? Subitement ou d’une longue maladie ? Avec ou sans assistance médicale ? En bénéficiant ou pas des soins antidouleurs ou palliatifs appropriés ? De même, importe-t-il d’évaluer l’action des pouvoirs publics pour accompagner la vie de nos concitoyens et faire en sorte que la mort advienne dans les meilleures conditions pour la personne comme pour son entourage. Pour que tous les Français puissent avoir une fin de vie apaisée.
Il y a urgence à faire un vrai bilan sur les conditions dans lesquelles on meurt en France aujourd’hui.
Deux tiers des patients qui devraient bénéficier d’une prise en charge en soins palliatifs n’y ont pas accès faute de moyens et un quart des départements ne disposent d’aucune unité de soins palliatifs.
Les 171 millions d’euros (dont 5 millions priorisés vers le renforcement des équipes mobiles en 2021) mobilisés pour doter tous les départements de structures palliatives à l’horizon 2024 et pour ouvrir de nouveaux lits dédiés constituent un engagement notable. Cependant, le manque de soignants risque de contredire les intentions affichées. Le développement d’une filière universitaire de médecine palliative ne peut être attractif que si des postes sont créés et pourvus.
Lors de la publication de la feuille de route[1] de ce plan le 27 janvier 2022, la SFAP (Société Française d’accompagnement et de soins palliatifs) a salué « le travail accompli » tout en soulignant son manque d’ambition, interrogeant notamment le manque d’engagements concrets pour pallier l’inégalité territoriale d’accès aux soins palliatifs.
Cette société experte propose un développement selon 3 axes – Garantir l’accès de tous aux soins palliatifs en développant l’offre de soins partout sur le territoire – Pouvoir choisir où finir sa vie : développer les soins palliatifs à domicile – Diffuser la culture palliative parmi les soignants et la population.
[1] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-fin-de-vie-2022-01-28-v1.pdf
Pendant la crise sanitaire liée au COVID-19, dans les EHPAD, les foyers pour personnes handicapées ou au sein des établissements hospitaliers, des malades en fin de vie, des personnes âgées, des concitoyens fragiles ont été privés de tout contact, les visites ayant été interdites. Derrière les portes closes, beaucoup de nos compatriotes sont décédés seuls, sans la présence et le soutien de leurs proches suscitant d’intenses souffrances et parfois de la colère légitime.
Il est juste et nécessaire que non seulement ces drames soient pleinement reconnus mais surtout que le législateur pose des garanties d’humanité afin qu’ils ne se reproduisent plus.


2.
Favoriser un écosystème pour la famille durable
La démographie est au cœur des enjeux d’avenir de la société française comme le souligne le rapport sur les enjeux démographiques du Haut-Commissaire au plan, François Bayrou. Il plaide pour un « pacte national pour la démographie », afin de sauver le modèle social français, et affiche parmi ses objectifs celui d’« avoir plus d’enfants ».
« Il faut une politique familiale qui permette aux gens d’avoir le nombre d’enfants qu’ils souhaitent », déclare à l’AFP François Bayrou, Haut-Commissaire au Plan (15 mai 2021) rappelant que « la dégradation de la natalité en France a été concomitante des mesures fiscales touchant notamment le quotient familial » et que la politique familiale ne peut se confondre avec une politique sociale.
La modulation des allocations familiales a eu des conséquences importantes pour les familles de la classe moyenne qui ont déjà subi l’abaissement du plafond du quotient familial lors de précédentes lois de finances. Elle a aussi ouvert la voie à une autre philosophie et à un autre modèle que celui imaginé par le Conseil national de la Résistance pour la mise en place de notre sécurité sociale.
Notre pays propose déjà des soutiens pour les couples et les familles. Ainsi l’Etat a mis en place des médiateurs familiaux afin d’aider les familles lors d’événements comme des deuils ou des ruptures. Ce dispositif reste largement méconnu. Surtout, il ne favorise pas assez la prévention des ruptures. Or, la politique familiale aurait tout à gagner à se préoccuper aussi de soutenir la stabilité des unions.
En France, selon l’INSEE les femmes enregistrent en moyenne une perte[1] de leur niveau de vie de 20% après un divorce.
On sait aussi qu’un tiers des foyers monoparentaux[2] vivent sous le seuil de pauvreté.
Notre proposition vise à renforcer la prévention des ruptures en favorisant un accompagnement conjugal accessible à tous les couples, des études[3] en démontrant les bénéfices et l’efficacité.
L’Etat pourrait financer des consultations parentales intégrant cet accompagnement, et intégrer la dimension de relation durable dans les interventions à destination des jeunes.
[1] https://www.insee.fr/fr/statistiques/3631116#titre-bloc-6
[2] https://www.insee.fr/fr/statistiques/5759045
[3] https://www.verslehaut.org/documents/prevenir-les-ruptures-conjugales-pour-proteger-les-enfants/
- apporter des solutions de logement, de garde d’enfant et des aménagements concrets de leurs études adaptées à leur situation de femmes enceintes et de jeunes parents ;
- élargir le RSA au couples étudiants qui attendent un enfant et/ou qui sont jeunes parents ;
- généraliser et déployer un service d’accompagnement et de soutien adapté comme le Samely[1] pour les lycéennes.
La situation spécifique des étudiantes mériterait d’être approfondie par les pouvoirs publics, en vue d’actions ciblées. L’Observatoire National de la Vie Etudiante a publié en octobre dernier les résultats de son étude « Etudier et avoir des enfants ». Ces résultats montrent combien la parentalité étudiante, qui ne remplit pas les conditions de relations de couple jugées solides, ni celle d’avoir un emploi stable et rémunérateur, apparaît comme un « impensé social » et n’est pas prise en compte dans le système éducatif français. Rien n’est prévu au niveau de l’organisation des études et des établissements pour les étudiants dans cette situation. Sans parler de la pression du regard de l’entourage (famille, amis…). L’arrivée d’une grossesse durant les études donne bien souvent lieu à son interruption. Chaque année 4% des étudiantes vivent une IVG. 85% des grossesses imprévues survenant pendant les études se terminent par une IVG et ce sont les 20-29 ans qui concentrent les plus forts taux d’IVG.
[1] Le SAMELY, dispositif créé par les PEP75 avec le soutien de la Région Ile-de-France et de l’Académie de Paris, permet de proposer un accompagnement global et adapté des lycéennes enceintes et jeunes mères dans leur suivi scolaire et autour du temps de la maternité.
La réforme de 2015 a limité ce congé à 2 ans par parent, au lieu de 3 auparavant pour la mère, soi-disant pour mieux partager ce congé avec les pères.
Le bilan de cette réforme est un échec :
- Alors que 0,5% des pères prenaient un congé parental à temps plein avant la réforme, ce taux est passé à seulement 0,8 % au lieu des 25 % attendus.
- Cette réforme a provoqué une baisse importante du nombre de bénéficiaires : 272 000 pères et mères fin 2018, soit 43 % de moins qu’avant la réforme.
Il faut revenir au minimum à un congé parental de 3 ans pour les mères avec une rémunération supérieure à celle offerte actuellement (la moitié du SMIC au lieu du tiers), ce qu’offrent déjà de nombreux pays européens.
On pourrait également étudier son allongement pour pouvoir articuler différentes périodes de disponibilité d’un parent entre la naissance et la majorité de l’enfant, selon ses besoins spécifiques (notamment pour raison de santé, à cause d’une maladie grave, d’un accident…) jusqu’à un total de 4 voire 5 années cumulées.
La durée du congé de paternité[1] a été doublée à partir du 1er juillet 2021 ; il est passé à 28 jours. Le bénéficiaire est tenu, pour être indemnisé, de prendre le congé de paternité et d’accueil de l’enfant dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, selon un calendrier de plusieurs jours bloqués. Laisser le libre choix au père[2] sur un temps plus long (un an) et selon un fractionnement adapté aux réels besoins du couple et de l’enfant favoriserait la possibilité de le prendre effectivement. Cette réforme contribuerait à responsabiliser les pères pour l’équilibre du couple en leur laissant le choix de décider ce qui est bon pour leur famille plutôt que de les enfermer dans des normes étatiques artificielles.
[1] https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3156
[2] https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/le-conge-de-paternite-un-droit-exerce-par-sept-peres-sur-dix
- organiser une grande campagne de sensibilisation des femmes de moins de 30 ans et des hommes sur l’importance de procréer à un âge où la fécondité est la plus favorable ;
- renforcer les recherches médicales contre l’infertilité, notamment celles induites par nos modes de vie ou des questions environnementales et celles pour trouver des traitements qui visent à restaurer la fertilité. Il n’est pas juste que la PMA soit proposée comme une réponse médicale précipitée alors que l’infertilité n’est pas médicalement constatée.
Des voix médicales et scientifiques de plus en plus nombreuses s’élèvent pour demander une éducation à la fertilité associée à l’éducation à la sexualité, qui serait une prévention de l’infertilité. Dans son avis n° 126 (p. 13) du 15 juin 2017, le CCNE alertait sur les conséquences individuelles et médicales des grossesses tardives : « la fréquence des complications, tant pour la mère (hypertension artérielle, diabète) que pour l’enfant (hypertrophie fœtale, prématurité), augmente rapidement avec l’âge de la mère et rend nécessaire une surveillance adaptée au risque encouru. Or, ces risques sont mal connus et sous-estimés par les femmes et leurs conjoints ».
Les mêmes voix demandent également que des mesures soient prises pour qu’il soit possible et facile de concilier grossesse, maternité et études ou entrée dans la vie professionnelle.
La France des droits de l’homme doit promouvoir cet interdit au niveau européen, puis mondial, au nom de la non-marchandisation du corps de la femme et du respect de la dignité de l’enfant, qui ne peut être considéré comme une marchandise que l’on pourrait donner ou vendre.
La GPA suppose une maltraitance originelle pour l’enfant puisque, dans son processus, il est un objet de contrat. La pratique de la GPA étant interdite en France, certains couples ou individus ont recours à celle-ci dans d’autres pays et font appel à des mère-porteuses étrangères. Ce phénomène a pour conséquence de favoriser le trafic humain, en contradiction totale avec les efforts internationaux de lutte contre un tel trafic.
- Résister à l’eugénisme en rééquilibrant les politiques de dépistage du handicap, avec en particulier un meilleur soutien des parents au moment de l’annonce.
- Lancer un plan quinquennal d’accompagnement et de prise en charge du handicap, doté de moyens financiers exceptionnels.
Beaucoup s’alarment d’une nouvelle forme d’eugénisme en France, qui stigmatise particulièrement les personnes porteuses de trisomie : 96 % des diagnostics de trisomie conduisent à une IMG. Une telle stigmatisation entrave gravement le droit des enfants handicapés à la vie et au développement.
Le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) dans un avis[1] publié en février 2022 (avis n°138, Eugénisme de quoi parle-t-on ? ) souligne que « le nombre important de recours à une interruption médicale de grossesse dans la cas d’un diagnostic de trisomie 21 (plus de 95% à l’heure actuelle) pourrait être le reflet de l’insuffisance des accompagnements et infrastructures proposées, et d’une insidieuse pression sociétale ».
La Rapporteuse spéciale des Nations-Unies sur les droits des personnes handicapées alerte sur cette situation[2] : « Sur les questions telles que le dépistage prénatal, l’avortement sélectif et le diagnostic génétique préimplantatoire, les militants des droits des personnes handicapées s’accordent à considérer que les analyses bioéthiques servent souvent de justification éthique à une nouvelle forme d’eugénisme, souvent qualifié de « libéral ».»
En 2016, le Comité [3] des droits de l’enfant de l’ONU déclarait être préoccupé par « la persistance de la discrimination à l’égard des enfants handicapés », notamment en termes « d’égalité avec les autres enfants ». À ce titre, il recommandait à l’État français de « mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés ».
Malheureusement, la législation française actuelle n’a pas amélioré la situation de ces enfants puisqu’elle encourage, par les pratiques de DPN et DPI, leur stigmatisation.
Selon la Rapporteuse spéciale[4], « de telles pratiques pourraient renforcer et valider sur le plan social le sentiment que les personnes handicapées sont des personnes qui n’auraient pas dû naître. Les cadres législatifs qui allongent les délais légaux d’avortement ou qui, à titre exceptionnel, autorisent l’avortement en cas de malformation du fœtus ne font que conforter un tel sentiment. En outre, le nombre de personnes handicapées à la naissance étant de ce fait moins élevé, certains craignent que cela nuise à leur défense et au soutien social qui leur est apporté. » Elle appelle à un changement d’approche s’agissant du handicap, « la question n’est pas tant de prévenir ou de soigner le handicap que de veiller à ce que toutes les personnes handicapées jouissent des mêmes droits et des mêmes possibilités que le reste de la population ».
[1] https://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/avis-138-du-ccne-leugenisme-de-quoi-parle-t
[2] A/HRC/43/41, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, Conseil des droits de l’homme, Quarante-troisième session, 24 février-20 mars 2020, §21
[3] CRC/C/FRA/CO/5, Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la France, Comité des droits de l’enfant, Soixante et onzième session (11-29 janvier 2016), §57.
[4] A/HRC/43/41, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, Conseil des droits de l’homme, Quarante-troisième session, 24 février-20 mars 2020, §32.
Aider les femmes à éviter l’avortement par une politique de prévention globale qui passe par :
- délivrer une information sur l’efficacité réelle de la contraception et ses échecs potentiels (72% des femmes qui avortent utilisaient un moyen de contraception lorsqu’elles ont découvert leur grossesse) ;
- apporter un soutien et l’accompagnement personnalisé des femmes enceintes en difficulté ;
- protéger les femmes face aux pressions et aux violences qu’elles peuvent subir pour les conduire à avorter ;
- former les personnels de santé et les acteurs sociaux aux pressions qui peuvent s’exercer sur les femmes enceintes
- Donner une information complète lors des consultations d’IVG sur les aides et droits spécifiques aux femmes enceintes.
L’urgence est à la protection des femmes contre toute violence, spécialement celles que constituent les pressions – souvent masculines – mais aussi sociales pour les femmes les plus vulnérables qui les poussent trop souvent à avorter à contrecœur. Toutes les femmes n’avortent pas librement et par choix.
Un sondage IFOP réalisé en octobre 2020 révèle que 92 % des Français jugent que l’avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre pour les femmes et 73 % estiment que la société devrait davantage aider les femmes à éviter le recours à l’interruption volontaire de grossesse.
La France manque d’études épidémiologiques sur les 20 dernières années, qui analyse les causes, les conditions et les conséquences de l’avortement. Ces données sont pourtant indispensables pour adapter les politiques aux besoins réels des femmes et des couples.
Allonger les délais de l’avortement[1] sans étude d’impact et sans qu’aucune mesure de soutien aux femmes ne soit proposée constitue dans ce contexte, une mesure injuste, déconnectée de la réalité.
En effet pour la première fois, les données sur l’IVG[2] ont été appariées avec des données fiscales pour l’année 2016, démontrant ainsi une corrélation nette entre niveau de vie et IVG : il en ressort que les femmes aux revenus les plus faibles y ont davantage recours. « Ces écarts ne s’expliquent pas uniquement par des différences d’âge ou de statut matrimonial de ces groupes de femmes, puisqu’à groupe d’âge et situation conjugale donnés, les femmes dont le niveau de vie est classé parmi les 10 % les moins élevés ont une probabilité de recourir à l’IVG dans l’année supérieure de 40 % à celle des femmes ayant un niveau de vie médian. » L’avortement peut s’avérer un marqueur d’inégalité sociale.
[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/renforcement_du_droit_a_lavortement
[2] Etudes et Résultats de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) du Ministère de la Santé. n° 1163 -septembre 2020
Renforcer, par tous moyens, la protection des mineurs contre la diffusion et l’accès de contenus à caractère pornographique, haineux ou violent doit être une priorité.
Dans un monde hyper connecté, où les enfants ont accès à internet dès le plus jeune âge, il apparaît capital de pouvoir réguler l’accès au web des publics les plus jeunes – et par conséquent, les plus vulnérables – afin de protéger au mieux leur santé tant psychique que physique.
Il importe de se préoccuper de la protection des enfants confrontés au développement de nouveaux équipements permettant l’accès à internet – smartphones, tablettes, consoles et objets connectés – ce qui ne fait que rendre plus difficile la tâche qui incombe aux parents, en rendant nécessaire la multiplication des logiciels et applications de contrôle parental.
Dans les faits, les enfants sont exposés excessivement tôt à des contenus inappropriés, choquants ou illégaux. On estime ainsi qu’à douze ans, un tiers des enfants a déjà été exposé à un contenu pornographique. Mais, au‑delà des images pornographiques, c’est également aux contenus haineux et violents, voire à l’action de réseaux criminels, terroristes et pédophiles, auxquels nos enfants peuvent être exposés. Les conséquences d’une telle exposition précoce pénalisent durablement les jeunes dans leur accès à une vie de couple épanouie.
3.
Soutenir les innovations technologiques garantes de la protection des plus fragiles
La recherche scientifique laisse espérer et entrevoir de nouvelles et permanentes avancées thérapeutiques. Mais certaines ont recours à l’utilisation d’êtres humains, en particulier des embryons humains, trop souvent considérés désormais comme un matériau de laboratoire dont l’accès est sans cesse facilité par la fragilisation des lois encadrant sa protection.
Compléter le champ d’application du principe de précaution en matière environnementale dans une approche d’écologie intégrale, pour y intégrer la protection et l’intégrité de l’être humain
Le principe de précaution a aujourd’hui valeur constitutionnelle quand il s’agit de l’environnement. L’argumentation de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, lors de l’examen de la loi bioéthique devant le Sénat en février 2020 est révélatrice de l’inconséquence des mesures votées dans cette loi: « le principe de précaution est à la fois un système d’évaluation et la mise en place de mesures proportionnées et provisoires en cas d’atteinte grave et irréversible. Or, en matière de bioéthique, je pense que si nous nous interrogions à l’infini sur ce qui est une atteinte grave et irréversible, nous aurions ici une difficulté. »
Or la loi bioéthique votée en 2021 a conduit à franchir des lignes rouges qui mettent en jeu l’intégrité de l’être humain :
- Les expérimentations aboutissant à la création d’embryons chimères mélangeant des cellules humaines –dont des cellules embryonnaires – et des embryons animaux ) dans divers axes de recherche, comme par exemple l’hypothétique « culture» d’organes ayant des critères humains dans des animaux génétiquement modifiés et d’obtenir des « greffons » présumés compatibles et fonctionnels.
- La modificationgénétique d’embryons humains avec l’utilisation de techniques de type CRISPR-Cas9, pour la recherche, a déjà ouvert à la création in vitro et à la naissance de bébés génétiquement modifiés (des enfants génétiquement modifiés sont déjà nés).
Un sondage IFOP publié en juin 2021 révèle une forte méconnaissance du contenu de la loi par les Français. Les résultats de ce sondage mettent en lumière leur souhait que soit appliqué un principe de précaution en matière de bioéthique. Trois Français sur quatre souhaitent que soient posées des limites aux recherches et aux applications qui mettent en cause l’intégrité de l’être humain et que soient interdites la création de chimères animal/homme et les modifications génétiques des embryons humains ».
- Réaffirmer un régime d’interdiction de recherche sur l’embryon humain ;
- obtenir un moratoire international de toute modification génétique des embryons humains, ainsi que sur les expérimentations sur les chimères homme animal et animal homme.
Il convient de réaffirmer également l’interdiction de la création d’embryons humains pour la recherche, y compris à partir de cellules germinales génétiquement modifiées ou obtenues par d’autres voies (gamètes dits « artificiels », crées à partir de cellules embryonnaires ou somatiques et modifiées par la technique des IPS : Cellules Souches Pluripotentes Induites)
Force est de constater que l’embryon humain est, aujourd’hui, considéré comme un cobaye « gratuit». Un des intérêts mis en avant est de pouvoir tester de nouvelles molécules ou de nouvelles thérapie ou réaliser des recherches en limitant le recours au modèle animal, plus onéreux, et nécessitent une formation et des installations spécifiques. Il importe donc de prohiber toute recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires dès lors qu’une alternative est possible.
Au titre des recherches alternatives, figurent les cellules souches adultes et, parmi elles, les cellules issues de sang de cordon et placentaire et la reprogrammation des cellules souches humaines adultes.
La montée en puissance de l’Intelligence Artificielle (évolution d’une IA faible vers une IA forte) induit de nouveaux enjeux, notamment avec le développement de robots médicaux ou d’assistance automatique aux diagnostics (médecine prédictive) ou de systèmes de recommandations de traitements. L’évolution de ces techniques a des objectifs de meilleur service auprès du patient ainsi qu’à une rationalisation des coûts de santé à des fins de meilleure gestion des comptes publics et des assurances privées.
Une réflexion sur la manière d’utiliser ces algorithmes est nécessaire afin de contenir et clarifier les risques de discriminations sanitaires des citoyens basés sur des évaluations de pathologies potentielles à venir, qui pourrait avoir un impact sur leur couverture maladies en fonction de leurs données passées et présentes de santé.
D’autre part, il est nécessaire d’être vigilant pour éviter une possible dégradation du service de santé avec des systèmes d’IA à bas coûts en aval (téléconsultation avec des « chatbots » médecins par exemple).
Ensuite, il est nécessaire de repenser l’interaction de ces systèmes d’assistance (conçus par des ingénieurs ou des « Data Analyst » sans connaissance et compétence médicale) avec les personnels soignants sur les critères décisionnels. Notamment, dans la formation initiale et continue des médecins, c’est une opportunité de recentrer et revaloriser la relation médecin-patient et le développement des intelligences corporelles, émotionnelle et relationnelles indispensables au traitement de maladies.
À chaque visite d’un site Internet, l’utilisateur laisse son empreinte numérique et ce, la plupart du temps, à son insu. Il est donc primordial de redonner le pouvoir et toutes les informations aux individus sur les données personnelles les concernant, en protégeant leur liberté d’accepter ou refuser leurs utilisations, leurs diffusions ou leurs stockages.
Aujourd’hui, la CNIL et l’UE par la RGPD contrôlent chaque personne morale ou physique proposant ses services en ligne afin de s’assurer qu’il soit permis à leurs utilisateurs de connaître la raison pour laquelle leurs données personnelles sont collectées et comment elles seront utilisées.
Cependant, un véritable basculement risque de s’opérer notamment depuis la crise sanitaire durant laquelle les Français ont été amenés à utiliser leurs smartphones (et autres objets connectés) pour utliser l’application Tous anticovid.
Une pratique qui pourrait être qualifiée d’“innovante” voire de cohérence avec les besoins en termes de distanciation sociale rencontrés. Cependant ces évolutions ne vont-elles pas ouvrir à une plus large utilisation de nos données de santé ? Nos institutions sont-elles prêtes à nous garantir une plus grande sécurité dans la gestion et l’utilisation de ces données à caractère sensible ?
C’est indubitablement une question à laquelle devra répondre le prochain gouvernement afin de garantir d’une part que chaque citoyen soit informé sur l’élargissement de ces pratiques et enfin, qu’il lui soit donné la possibilité de refuser en cas de désaccord.
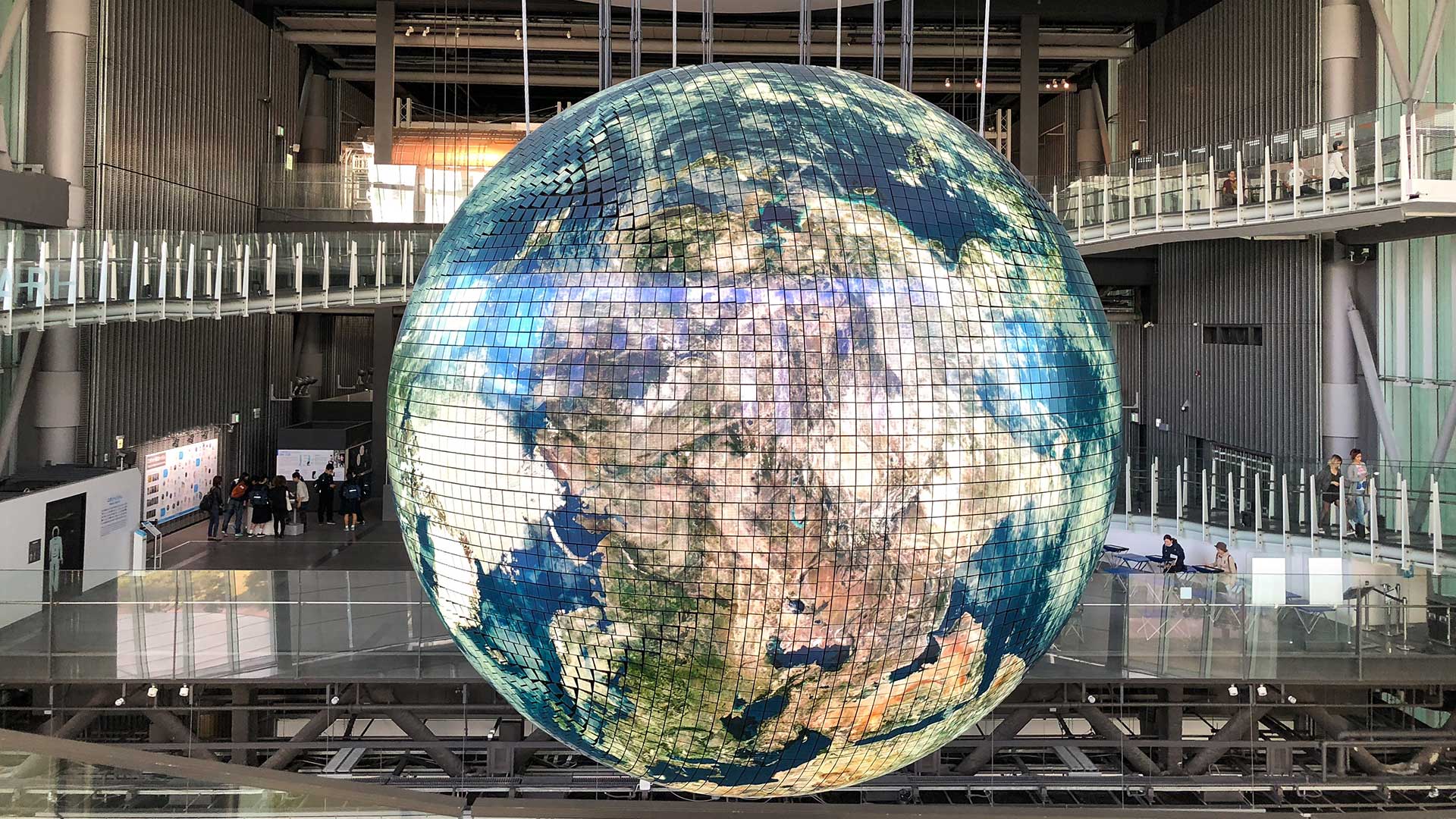
Agir avec Alliance VITA
Soutenir notre appel