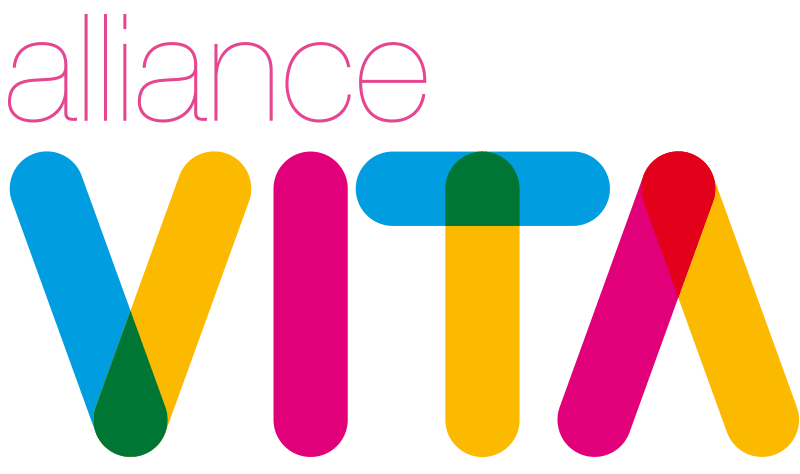Natalité et infertilité : vide éthique du CCNE
Le 3 avril 2025, le Comité Consultatif National d’Éthique pour les sciences de la vie et de la santé (C.C.N.E.) a publié un nouvel Avis sur la baisse de la natalité et de la fertilité. Il fait suite à une saisine du ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention, demandant au Comité de formuler des recommandations en vue d’un « grand plan de lutte contre l’infertilité ».
En effet, la natalité baisse en France et l’infertilité augmente. Même si les deux phénomènes ne sont pas totalement corrélés et suivent des dynamiques distinctes, le CCNE les a traités dans un même avis.
Que constate le CCNE ?
Sur les raisons de la baisse de la natalité ?
Le CCNE confirme des constats qui ne sont pas nouveaux, liés à des dimensions socio-économiques, culturelles et sociétales. Il confirme également que le recul de l’âge de la maternité est un phénomène déterminant dans la baisse de la natalité. Il recommande d’ailleurs à la fin de son avis que « les médecins sensibilisent plus leurs patientes sur l’existence de risques accrus de complications ou de mortalité maternelle ou infantile lors des grossesses tardives, en particulier pour les primipares. »
Il rappelle aussi cette double augmentation : celle des femmes et couples en situation de « non désir d’enfant » volontaire (childfree). Et celle de ceux qui regrettent de ne pas en avoir, en raison de facteurs extérieurs (médicaux ou économiques) subis dits « childless ».
Le CCNE mentionne par ailleurs l’évolution de la place des femmes dans la société, la baisse de la sexualité et le mouvement global en cours dit de « déconjugalisation » (augmentation des taux de célibat). Dans « les sociétés modernes, les relations ne sont pas seulement moins fréquentes, elles sont aussi de plus en plus fragiles »[1]
Sur la hausse de l’infertilité ?
Là aussi, le CCNE reprend des constats existants sur les causes de la baisse de la fertilité : modes de vie, obésité, impact environnemental, en particulier des perturbateurs endocriniens. À ce titre, le CCNE rappelle l’existence d’une dimension transgénérationnelle de ce problème. Les études mettent en lumière un lien entre l’exposition aux perturbateurs endocriniens durant la grossesse et des troubles de la reproduction chez les descendants, en raison de modifications épigénétiques héréditaires.
Sur les limites de l’assistance médicale à la procréation (AMP)
Le CCNE estime que la hausse de l’infertilité vient aussi des mauvais résultats constatés en AMP. Il rappelle que « L’AMP n’est pas une solution à tout : elle ne permet pas à tous les couples et à toutes les femmes d’obtenir l’enfant désiré ». Le comité estime même que « les vrais résultats, tels que fournis par l’Agence de Biomédecine (ABM), devraient être mieux diffusés dans la population générale ».
Le CCNE précise que « les derniers chiffres font état de l’obtention d’une médiane de 19 % d’accouchements après une ponction FIV/ICSI[2] ». En somme, à chaque tentative, on est sur une moyenne d’une chance sur 5 d’aboutir à une naissance… Mais l’information sur cette efficacité fait défaut et les Français n’en ont pas assez conscience, déplore encore le CCNE. « L’attribution à la médecine d’un pouvoir quasi magique est suivie d’un temps de désillusionnement douloureux » : parcours d’AMP éprouvants, échecs fréquents, attente, angoisse, déception, conséquences sur la vie sexuelle et relationnelle des couples, diminution du désir, intrusion de la technique médicale dans l’intimité de leur vie sexuelle, tensions, blessures narcissiques…
Par ailleurs, le CCNE reconnait que le mode de conception peut ne pas être anodin et recommande que les parents soient encouragés à informer eux-mêmes leurs enfants de leur mode de conception.
Pourtant, ces constats n’empêchent pas les auteurs de conclure à la nécessité de favoriser une augmentation d’activité en AMP pour obtenir un effet sur la natalité, même s’il serait limité….
Que recommande le CCNE ?
Sur la baisse de la natalité ?
Il reconnaît que les réponses à la baisse de la natalité, actuellement enregistrée par la France, sont avant tout politiques (dans le sens des politiques publiques) ; ses déterminants étant essentiellement culturels, mais aussi économiques et sociaux.
La principale recommandation concerne la prise en charge de la petite enfance et des différents modes de garde des enfants, à des coûts supportables par les parents. Mais aussi les allocations familiales, avantages fiscaux et accès à des logements compatibles avec la parentalité, l’amélioration de l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle (congés familiaux et autres accompagnements) et la valorisation d’une meilleure répartition des tâches entre hommes et femmes.
Mais il plaide aussi pour le respect de « l’autonomie reproductive » des personnes et rappelle qu’il ne serait pas éthique d’exercer une pression, même implicite, par quelque technique que ce soit et quelles que soient les raisons avancées, sur les femmes et les hommes qui ne veulent pas d’enfant, à en avoir.
Face à l’augmentation de l’infertilité ?
Il appelle à l’intensification de l’information délivrée à l’égard de la population générale, sur la fertilité, ses déterminants (alimentation, facteurs extérieurs, perturbateurs endocriniens…), sa temporalité : toutes les informations doivent être données de façon positive sans intention de culpabiliser ni d’inciter les femmes et /ou les couples à avoir des enfants. Il encourage à éviter de tomber dans l’injonction d’avoir des enfants comme dans celle de répondre sans limite à tout désir d’enfant.
Il propose d’encourager le développement des plateformes PREVENIR (Prévention Environnement Reproduction). Ces structures sont dédiées à l’évaluation des expositions environnementales chez des patients pris en charge pour des troubles de la reproduction (troubles de la fertilité, pathologies de grossesse, malformations congénitales).
Il recommande la création d’un logo « produit reprotoxique » (présence de pesticides, de perturbateurs endocriniens etc.) sur les produits de consommation.
Concernant l’AMP et la santé des enfants à naître
Le CCNE appelle à l’intensification de l’information délivrée à l’égard de la population générale sur l’autoconservation ovocytaire et les différentes techniques d’AMP, leurs succès et leurs limites : la complexité des parcours, les résultats non garantis, les souffrances associées.
Il recommande qu’une information claire, objective et la plus précise possible soit délivrée aux personnes souhaitant devenir parents en ayant recours à une AMP sur les incertitudes qui subsistent, sur les risques liés aux techniques de PMA sur la santé de l’enfant à naitre, même si la très grande majorité des enfants de l’AMP sont en bonne santé physique et psychique.
Les paradoxes du CCNE, et ses lignes ni claires, ni durables
Sur la question de l’autoconservation des ovocytes
Le CCNE en reconnait les nombreuses limites, risques, l’inutilité du processus puisque moins de 10% des femmes ont réellement besoin ultérieurement d’utiliser leurs ovocytes congelés et concevront naturellement, ainsi que le fort taux d’échec : « il n’y a pas de garantie absolue de grossesse ultérieure ». Et il reprend ici ses affirmations de 2017, dans son avis 126 : « la proposition d’autoconservation ovocytaire à toutes les femmes jeunes qui le demandent en vue d’une hypothétique utilisation ultérieure parait difficile à défendre »
Pourtant, après l’exposé de ces constats négatifs, le CCNE se demande : « ne devrions-nous pas proposer l’auto-conservation d’ovocytes, à toutes les femmes de 30 ans et plus qui ne peuvent réaliser leur projet de grossesse faute de partenaires ou de conditions favorables ? »… Et pondère cette suggestion ainsi : « Cependant, cette proposition ne paraît pas réaliste dans le contexte actuel, au regard des délais conséquents de prise en charge inhérents à l’afflux de demandes ».
Cela va dans le même sens que les déclarations du président Macron dans Elle, au sujet du « réarmement démographique ». Il avait annoncé « Nous allons ouvrir aux centres privés l’autoconservation ovocytaire. Elle était jusqu’ici réservée aux établissements hospitaliers » et l’organisation de « campagnes en faveur de l’autoconservation d’ovocytes pour les femmes qui veulent avoir des enfants plus tard ».
Sur la protection de la non-marchandisation des corps
Le CCNE se dit favorable à l’ouverture de centres d’AMP privés, donc clairement à but lucratif, mais prétend vouloir protéger la non-marchandisation, la non-contractualisation de la reproduction humaine… le CCNE estime même qu’il faut exiger des centres un quota minimum d’autoconservation dans leur activité ! Pourtant, le CCNE rappelle qu’il reste attaché aux principes qui la régissent aujourd’hui, à savoir : le respect de la dignité, qui se traduit par la non-patrimonialité du corps humain, la gratuité du don afin de garantir la non-marchandisation, la non-contractualisation de la reproduction humaine… Le CCNE semble avoir adopté un raisonnement du « en même-temps » cher à notre époque…
Par ailleurs, le CCNE conseille de renforcer encore les campagnes d’information sur le don de spermatozoïdes pour essayer d’augmenter le nombre de donneurs… alors qu’elles ont déjà fait plusieurs preuve fois la preuve de leur inefficacité, pour un coût exorbitant, sur fonds publics…
Sur le recours aux banques de gamètes étrangères
Le CCNE rappelle les risques qu’il y aurait à ouvrir légalement l’accès aux banques de sperme étrangères mais ne recommande pas dans son Avis de maintenir l’interdiction…
En effet, selon lui, puisque l’AMP est désormais ouverte aux femmes seules ou en couple de femmes, avec recours au don de sperme, le CCNE recommande de renforcer les moyens humains et matériels des centres pour mieux répondre à cette demande. Le comité se demande donc s ’il ne faut pas autoriser clairement l’accès aux banques étrangères de sperme. Puisque « ces banques livrent en France, après commande en ligne des femmes et que certains médecins acceptent d’utiliser ces paillettes ».
On relèvera la légèreté de l’argumentation… Puisque « ça se fait », faisons-le…
Sur l’âge du recours à l’AMP
Par ailleurs le CCNE se demande s’il faudrait créer une limite d’âge inférieur pour pouvoir bénéficier du recours à l’AMP, en particulier pour les femmes jeunes, non infertiles, mais ne propose pas de réponse.
La difficulté à raisonner en profondeur sur l’intérêt supérieur de l’enfant
Le droit de l’enfant à connaitre ses origines, s’il a évolué dans la loi bioéthique de 2021, reste complexe et n’a pas remis en cause la cause même de ce problème : à savoir, l’accès aux dons de gamètes anonymes. Des dispositions qui sont dès l’origine contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Sur la question de l’ « autonomie »
D’un côté, l’idée d’autonomie irrigue le texte. De l’autre, les limites, risques et échecs de l’AMP sont clairement rappelés. Pourtant, le CCNE est favorable à ce que toutes les femmes et les hommes puissent bénéficier s’ils le souhaitent d’une préservation de leur fertilité sans autre raison que l’âge (auto-conservation ovocytaire ou de sperme). Cette technique oblige pourtant les femmes et les couples à en passer par la technique pour avoir des enfants (en hypothéquant ainsi leur autonomie de procréer tout seul).
Sur la question de la PMA post-mortem
Le CCNE commence par rappeler que « faire naître un enfant orphelin n’a rien d’anodin ». Mais en même temps, puisque que la loi française autorise désormais toute femme seule à faire appel à un don de sperme, doit-on maintenir cette interdiction ? Il propose que cela fasse l’objet d’une évaluation lors des prochains états généraux de la bioéthique.
Sur la méthode dite « ROPA » (réception d’ovocyte de la partenaire)
La loi actuelle n’autorise pas cette technique qui consiste en un don d’ovocyte d’une femme à sa conjointe qui portera ensuite l’enfant conçu avec cet ovocyte et un don de sperme anonyme. Mais puisque l’AMP est désormais possible pour les couples de femmes et que la loi permet qu’il y ait deux mères à l’état civil, pourquoi ne pas autoriser cet énième bricolage procréatif ? Ici, le CCNE oublie complétement de rappeler les risques plus importants des grossesses quand l’enfant ne partage en rien le patrimoine génétique de sa mère.
Finalement, si ce nouvel avis relève des points importants, ses recommandations manquent largement de cohérence.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :