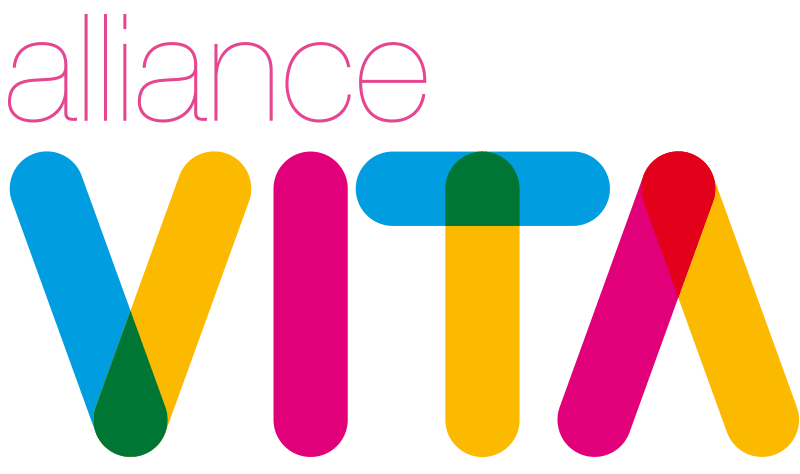Hausse de la mortalité infantile en France : quelles explications ?
4,1 décès pour mille naissances, la France mauvaise élève de l’Union européenne en termes de mortalité infantile : c’est le constat alarmant que tentent de comprendre Anthony Cortes et Sébastien Leurquin dans leur livre-enquête. Alors que le taux de décès des bébés de moins d’un an diminue partout ailleurs chez nos voisins européens, et que notre natalité baisse, comment expliquer ce chiffre ?
Le taux de mortalité infantile en France en 2024 : un état des lieux
La mortalité infantile (enfants nés vivants et décédés à moins d’un an) se calcule en nombre d’enfants morts par rapport au total des naissances vivantes. Si ce taux a largement baissé tout au long du XXe siècle, passant d’un pic de 163 pour 1000 (en 1911, en raison de la canicule) et autour des 18 pour 1000 dans les années 1970 jusqu’à atteindre 3,5 pour 1000 en 2011, il est actuellement en augmentation (constante depuis 2020), passant de 3,9 en 2023 à 4,1 en 2024.
Pour mieux comprendre, il est intéressant de regarder quel est le taux de mortalité infantile actuel dans les autres pays européens. Alors que la France était dans le trio de tête entre 1996 et 2000, elle est aujourd’hui classée 23e sur 27, entre la Pologne et la Bulgarie et à égalité avec la Croatie, alors que ces pays sont moins riches que le nôtre.
Il est important aussi de remettre du concret derrière ce taux qui peut paraître froid : ce sont 2800 bébés nés vivants qui meurent chaque année en France avant d’avoir soufflé leur première bougie, et autant de familles endeuillées, dans un pays par ailleurs 7e puissance mondiale. Alors même que la natalité est en berne, et qu’Emmanuel Macron a parlé de « réarmement démographique », les familles rencontrées par les deux journalistes déplorent la manière dont sont pris en charge les nouveau-nés.
Qu’est-ce qui explique l’augmentation du taux de mortalité infantile ?
Dans leur enquête (parue en mars 2025 aux éditions Buchet-Chastel), les auteurs sont allés interroger de nombreux acteurs : parents, sage-femmes, médecins et autres personnels médicaux, mais aussi responsables politiques. A plusieurs reprises, on leur a répondu que l’augmentation de la mortalité infantile était liée à de multiples facteurs, dont l’augmentation de l’âge des mères, le surpoids, le tabagisme, la précarité… Mais, interrogent-ils, comment se fait-il que l’on observe une différence avec de nombreux pays de l’Union européenne, quand les problématiques citées ne sont pas propres à la France ?
Quelles sont les spécificités du contexte français de l’accouchement et de la prise en charge des nouveau-nés qui pourraient expliquer le mauvais classement de notre pays en matière de mortalité infantile ? Les auteurs en identifient plusieurs :
- La fermeture des petites maternités. Les trois quarts des maternités ont fermé en moins de 50 ans : de 1369 maternités en France en 1975, on est passé à 457 en 2019 ! Assumée comme une stratégie dans les années 1970, la fermeture des maternités réalisant moins de 300 accouchements par an avait pour objectif d’orienter les parturientes vers des maternités plus spécialisées, mieux à même de réagir en cas de complications. Le personnel des petites maternités, réalisant moins d’actes, était aussi considéré comme pas assez entraîné. Dans un premier temps, cette réorganisation a en effet permis de faire baisser la mortalité infantile.
Toutefois, à partir des années 1990, cette diminution drastique a eu deux conséquences :
- La surcharge des maternités restantes. Mécaniquement, les grosses structures se sont retrouvées maternité de référence pour un très grand nombre de femmes, tout en subissant un manque de personnel. Le recours aux intérimaires, solution provisoire, entraînant à la fois des trous dans le budget (en raison de rémunération pouvant aller jusqu’à plus de 7000€ bruts par mois pour trois demi-journées de travail) et un manque de cohésion au sein des équipes médicales.
- L’augmentation de la distance entre les femmes et les maternités. La distance moyenne entre les femmes en âge de procréer et les maternités ne cesse en effet de croître : plus de 900 000 de ces femmes vivent aujourd’hui à plus de 30 minutes de la première maternité, et la part de celles qui habitent à plus de 45 minutes a augmenté de 40% depuis 2000. Or, selon une étude menée en Bourgogne, le taux de mortalité infantile autour de l’accouchement est multiplié par deux avec un trajet de plus de 45 minutes. Si la classification des maternités en type 1 (accouchements sans complication), 2 (avec service de néonatologie) et 3 (avec service de réanimation néonatale) a permis de mieux prendre en charge les accouchements compliqués, elle a aussi pu éloigner certaines femmes des services de base.
- Réduction des césariennes. Les auteurs évoquent aussi cette recommandation faite en 2012 par la Haute Autorité de santé, incitant les gynécologues obstétriciens à privilégier l’accouchement par voie basse dans quatre cas qui jusque-là donnaient plutôt lieu à des césariennes programmées (l’accouchement de jumeaux ; d’un gros bébé ; d’un bébé qui se présente en siège ; pour une maman qui a déjà subi une césarienne). S’il y a des complications lors d’un accouchement par voie basse, on procède alors à une césarienne d’urgence : or celle-ci multiplie par 6 ou 7 le risque de mortalité du bébé.
- Dégradation du suivi des prématurés. Le manque de moyens et de personnel affecte également la prise en charge des nouveau-nés prématurés, augmentant leur vulnérabilité.
- Manque de moyens pour la protection maternelle et infantile (PMI). Le suivi post-accouchement est lui aussi en crise. Les services de PMI ont vu leurs moyens diminuer. Or, c’est dans les premières semaines que de nombreuses pathologies ou vulnérabilités peuvent être détectées et prises en charge. Le manque de visites à domicile, de consultations pédiatriques ou de relais sociaux laisse des familles seules, parfois démunies, face à des signaux d’alerte.
Préconisation pour réduire la mortalité infantile en France
Les auteurs, tous deux journalistes, formulent des propositions concrètes pour réagir et faire à nouveau diminuer la mortalité infantile en France :
- Réouverture ou création de maternités de proximité, même de petite taille.
- Renforcement du suivi postnatal, notamment par les services de PMI.
- Création d’un registre des naissances et de la mortalité infantile, pour un suivi scientifique rigoureux.
- Revalorisation du rôle des sage-femmes, avec des parcours plus personnalisés et humains.
- Investissement dans la prévention, plutôt que la réponse uniquement médicale aux complications.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :