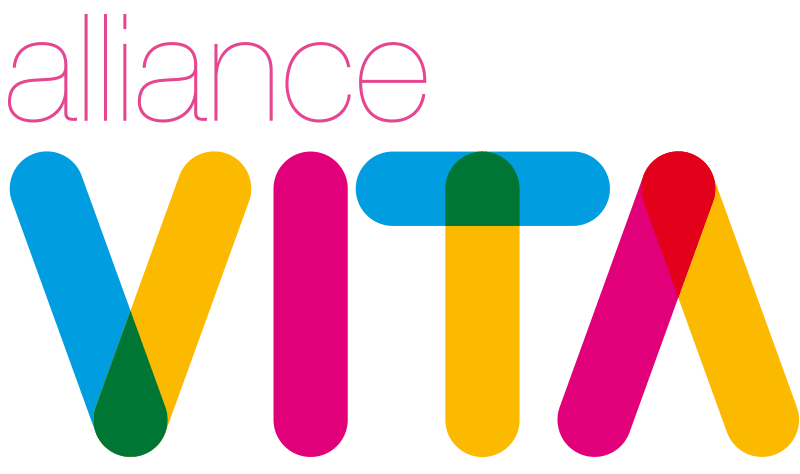Rapport quinquennal : l’euthanasie au Québec n’est plus un « soin » d’exception
Un rapport sur la situation des soins de fin de vie entre 2018 et 2023 au Québec, montre la place importante qu’occupe désormais l’aide médicale à mourir (AMM), c’est-à-dire l’euthanasie, dans la société québécoise. La Commission à l’origine de ce travail fait ainsi le constat que « bien que l’AMM demeure, dans la majorité des cas, un soin de dernier recours, ce n’est plus un soin d’exception, mais plutôt une option considérée parmi les soins de fin de vie ».
Le cadre légal de l’AMM n’a cessé de s’élargir en 10 ans
Le Québec a adopté en 2014 la Loi concernant les soins de fin de vie (LCSFV) qui autorise l’euthanasie sous le vocable « aide médicale à mourir » plus couramment nommée AMM. Initialement, pour accéder à l’AMM, il fallait être majeur et apte à consentir aux soins, être en fin de vie à la suite d’une maladie grave et incurable et éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et inapaisables. En moins de 10 ans, les critères d’éligibilité à l’AMM n’ont cessé d’être élargis :
- suppression du critère de fin de vie ou de la mort naturelle raisonnablement prévisible,
- accès élargi aux personnes atteintes d’une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude en 2021 et aux personnes atteintes de déficiences physiques graves au printemps 2024,
- possibilité de demander l’AMM de manière anticipée depuis octobre 2024.
En outre les maisons de soins palliatifs ne peuvent plus se soustraire à la pratique de l’euthanasie en leur sein depuis décembre 2023.
Néanmoins les données de ce rapport quinquennal ne prennent pas en compte les modifications légales intervenues après mars 2023.
Augmentation du nombre de morts par AMM
14 417 personnes ont reçu l’AMM entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2023. Le nombre de personnes qui ont reçu l’AMM est en croissance depuis l’entrée en vigueur de la Loi. L’augmentation annuelle a été en moyenne de 41 %. En 2022-2023, le nombre d’AMM administrées est près de dix fois celui de 2016-2017. Les décès par AMM représentent 6,2 % de l’ensemble des décès en 2022.
La proportion des personnes avec un pronostic vital supérieur à 6 mois a augmenté entre 2018 et 2023. En effet, le nombre de personnes avec un pronostic estimé à un an ou moins a augmenté graduellement, passant de 3,6 % en 2018-2019 à 8,5 % en 2022-2023.
Parmi les incapacités et les souffrances rapportées, la perte de capacité à effectuer les activités qui donnaient du sens à la vie ou les activités de la vie quotidienne, menant à une dépendance à autrui, arrive en tête ; le sentiment de perte de dignité est également très fréquent.
Au Québec, le taux de décès par AMM n’en fait plus un soin d’exception. L’AMM fait maintenant partie du continuum des soins de fin de vie.
Un raccourcissement des délais entre la demande et l’administration de l’AMM
45,7 % des personnes ont reçu l’AMM moins de 10 jours après avoir signé le formulaire de demande. Au Québec, la loi ne précise pas la durée du délai entre la demande et l’administration de l’AMM. Pour autant les membres de la Commission estiment que « la décision doit être mûrie, réfléchie et faire l’objet d’entretiens espacés avec le médecin. ». Pour eux l’AMM ne peut être un soin d’urgence effectué dans la précipitation, or le délai d’un jour ou moins entre la demande et l’administration de l’AMM est rare, mais il existe : il a été rapporté dans 3,6 % (514/14 417) des formulaires des AMM administrées entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2023.
Le pourcentage de décès par l’AMM est le plus élevé au monde
Par rapport à la Belgique et aux Pays-Bas dont les critères d‘admissibilité à l’euthanasie sont similaires, la croissance annuelle du nombre d’euthanasies par million de population est beaucoup plus élevée au Québec et au Canada (30 % à 50 %) qu’en Belgique et aux Pays-Bas (10 % à 20%).
Pour l’année 2022, la proportion de décès par euthanasie était de 5,4 % aux Pays-Bas, 3,1 % en Belgique, et 4,1 % dans l’ensemble du Canada (incluant le Québec). La Commission fait le constat du taux élevé d’AMM au Québec sans pouvoir l’expliquer.
Des données qui ne permettent pas d’évaluer l’accès et la qualité des soins palliatifs
Face au manque de données permettant de mesurer et d’évaluer l’accès et la qualité des soins palliatifs, la Commission a consulté des organismes et experts spécialisés et un sondage a été soumis aux participants du congrès annuel de l’Association québécoise des soins palliatifs en 2023. Il en ressort les enseignements suivants :
- Une disparité de l’offre de soins et de services selon la région et un référencement tardif.
- Des difficultés dans les trajectoires de soins et de services.
- Un manque de médecins disponibles pour dispenser des soins palliatifs à domicile dans plusieurs régions du Québec.
- Un nombre de médecins exerçant en soins palliatifs insuffisant pour répondre aux besoins.
- Des intervenants et des équipes de soins insuffisamment formés pour offrir des soins palliatifs de base de qualité ou pour le repérage précoce des personnes qui pourraient en bénéficier.
- Un manque d’information accessible à la population.
Le manque de données, qu’elle constate et déplore, n’empêche pas la Commission de signaler sans embarras que la grande majorité des personnes ayant reçu l’AMM bénéficiaient de soins palliatifs.
Le réseau citoyen Vivre dans la dignité s’interroge à juste titre : « quelle proportion de ces personnes a eu accès à des soins palliatifs complets au bon moment et avec une approche interdisciplinaire à la fois bio, psycho, socio et spirituelle ? Une approche uniquement pharmacologique (telle que la simple administration de morphine) pourrait être qualifiée de soins palliatifs alors qu’elle est fort réductrice. Pour un réel choix en fin de vie, les Québécoises et les Québécois doivent avoir accès à des soins palliatifs dignes de ce nom qui répondent adéquatement aux souffrances physiques, psychologiques et existentielles. »
D’ailleurs certains experts et répondants au sondage ont exprimé la crainte que des difficultés d’accès aux soins palliatifs pourraient inciter certaines personnes à demander l’AMM pour soulager une souffrance qui aurait pu être apaisée avec ces soins.
Le constat d’une banalisation de la mort provoquée
10 ans après l’autorisation de l’aide médicale à mourir, voulue alors comme un soin exceptionnel, les critères ont été élargis si bien qu’aujourd’hui, le pourcentage des morts par euthanasie au Québec est le plus élevé au monde.
La Loi concernant les soins de fin de vie adoptée en 2015 a fait le choix d’englober soins palliatifs et mort provoquée dans un continuum de soins conduisant à la banalisation de l’AMM désormais perçue comme un soin comme un autre en fin de vie. D’élargissement en élargissement, l’AMM pourrait à terme devenir un « soin » à la demande sans d’autre critère que la volonté de la personne.
Dans un addendum consacré à l’éthique de l’AMM au Québec, Eugene Bereza et Véronique Fraser (membres ancien et actuelle de la Commission) se demandent s’il est « éthiquement acceptable que la pauvreté, l’isolement social, le refus d’aller à un CHSLD (Centre d’hébergement et de soins de longue durée) ou le manque d’accès aux soins soient des facteurs qui contribuent de manière significative à l’expérience subjective de souffrance intolérable d’une personne et conduisent à la demande d’AMM ? ».
Cependant, les deux auteurs semblent aussi penser que les principes éthiques fondés sur des règles sont relatifs face à la souffrance. Ethique et souffrance ne devraient pourtant jamais être opposées. Il s’agit bien au contraire de prendre en charge et d’accompagner la souffrance dans le respect des principes d’humanité et de fraternité indissociables de l’interdit de tuer.
A l’heure où les discussions autour d’une possible légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté en France pourraient reprendre en mai à l’Assemblée nationale, l’exemple québécois nous montre combien les critères présentés comme des garde-fous sont illusoires. Il révèle aussi que faire de l’euthanasie une option de soin comme une autre, banalise la mort provoquée et dénature les soins palliatifs.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :