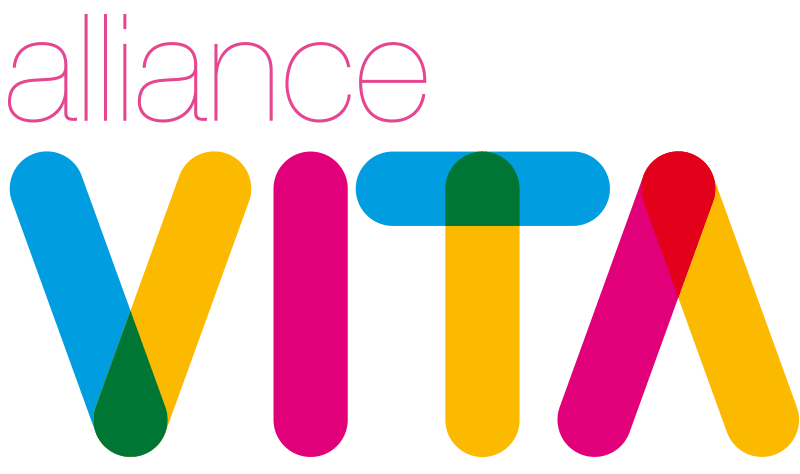La maturation in vitro (MIV) des ovocytes
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une technique utilisée dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Elle consiste à prélever les ovocytes immatures au sein des ovaires et à les faire « murir » à l’extérieur du corps, in vitro, en laboratoire, de manière artificielle.
Le premier bébé né par cette technique en 1991 viendrait de Corée. Plusieurs équipes travaillent sur ce sujet dans le monde. Au Vietnam, en Belgique, aux Etats-Unis…
En 2019 en France, la naissance de jumeaux par cette technique chez une femme de 35 ans souffrant d’insuffisance ovarienne auto-immune (autrement dit de ménopause précoce) a été annoncée comme une première mondiale.
Pourquoi cette technique ?
L’objectif des techniques de MIV est de réduire le recours aux hormones. Et donc d’éviter l’étape de la stimulation ovarienne, par injections d’hormones, qui visent à maximiser les chances de récupérer plusieurs ovocytes lors du prélèvement. Celles-ci présentent en effet des risques d’inconforts et d’effets secondaires, parfois graves. Pour certaines femmes, la stimulation ovarienne est contre-indiquée. Les techniques de MIV seraient particulièrement préconisées chez les femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques, chez qui le risque de développer une hyperstimulation grave pourrait mettre en jeu le pronostic vital.
Le prélèvement des ovocytes est réalisé dans deux situations : soit lorsqu’un processus de PMA avec Fécondation in vitro (FIV) est enclenché. Soit lorsqu’on souhaite procéder à la cryoconservation des ovocytes. La mise en place d’une conservation des ovocytes a lieu soit pour raisons médicales (comme avant de subir un traitement lourd type chimiothérapie, par exemple) soit pour des raisons de convenance personnelle (possible en France depuis la loi de bioéthique d’août 2021 pour les femmes âgées de 29 à 37 ans).
Dans certains pays, où la « vente » de gamètes n’est pas interdite, certaines femmes choisissent de se faire prélever leurs ovocytes dans cette optique financière. Ce marché existe, il est alimenté par la demande des femmes ayant des difficultés à procréer et par la pratique de la gestation pour autrui (GPA) où, couramment, les commanditaires ont recours d’un côté, à l’achat d’ovocytes, de l’autre, à une mère porteuse. Ce marché des ovocytes est aussi alimenté par la recherche.
Qu’est-ce que « la maturation » des ovocytes ?
La fabrication naturelle des ovocytes au sein de l’ovaire féminin est un processus très long et complexe qui débute pour la petite fille dès sa vie in utero. Si une cellule parvient à effectuer un « cycle complet », celui-ci aura débuté lors du premier mois de grossesse, par l’apparition des cellules germinales, et se conclura par sa fécondation, qui « achève » sa maturation et lui donnera le nom d’ovule.
Toutes ces étapes de maturation constituent ce qu’on appelle la méiose, et permettent d’aboutir à des cellules qui n’auront pas 46 chromosomes, comme le reste des cellules du corps, mais seulement 23. C’est la particularité des gamètes : ne contenir que 23 chromosomes, pour que la fécondation, la fusion avec la cellule de l’autre sexe, aboutisse à la conception du zygote, la première cellule du nouvel individu composée de 46 chromosomes, 23 paternels et 23 maternels.
Les ovocytes I se développent pendant les premiers mois de la grossesse. Ces cellules ont encore 46 chromosomes. On parle de « réserve folliculaire ». Celle–ci ne sera pas régénérée, et ne cessera de décroître, dès la vie in utero. A la puberté, le « stock » de follicules ne sera que d’environ 400 000 follicules. Parmi eux, seuls 400 vont arriver à maturité et aboutir à l’ovulation, pendant la période qui va de la puberté à la ménopause.
Au cours du cycle menstruel féminin, lors de l’ovulation (expulsion hors de l’ovaire), un ovocyte I (parfois plusieurs) par cycle reprend sa division de méiose. Ce processus de maturation conduit à un ovocyte II, composé de 23 chromosomes.
Ce processus de maturation lié à l’ovulation se produit en lien avec tout le microenvironnement présent chez la jeune femme. La maturation intervient en réponse à des signaux complexes, régulés dans le temps, sous l’impulsion d’hormones, de facteurs de croissance et dans une dynamique liée à la présence de nutriments dans l’environnement folliculaire. Beaucoup de ces processus sont régulés par les cellules ovariennes.
Cette lente maturation a pour objectif un fort accroissement de la cellule ; il s’agit d’une « préparation » à une éventuelle fécondation. L’ovocyte II contient la moitié du matériel génétique qui contribue au futur zygote après la fécondation, mais aussi le génome mitochondrial et l’ensemble du cytoplasme du futur zygote. Ce cytoplasme contient des réserves énergétiques nécessaires au développement du futur embryon.
Comment faire « murir » artificiellement les ovocytes ?
Gameto, une société de biotechnologie basée au Texas, utilise des cellules souches pluripotentes induites (IPS), leur « technologie de cellules de soutien ovarien (OSC) » s’appelle Fertilo. Gameto vient d’annoncer avoir obtenu une autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) pour procéder à un premier essai clinique de phase 3. Cette autorisation fait suite à la première naissance d’un enfant conçu en utilisant cette technologie Fertilo, dans une clinique de Lima, au Pérou, en décembre 2024. Cet essai clinique va se dérouler dans 15 sites aux États-Unis. Il évaluera les taux de grossesse (en tant que mesure de l’efficacité), le développement de l’embryon, la santé maternelle et les taux de naissances vivantes (en tant que critères d’innocuité).
Ses concepteurs mettent en avant que seuls 3 jours de stimulation sont nécessaires, contre les 2 semaines habituelles en FIV dite classique.
Pour murir les ovocytes de manière artificielle et hors du corps, Fertilo recrée un environnement ovarien et mise sur la co-culture des ovocytes immatures avec des cellules de soutien ovarien (OSC) obtenus par la technique de reprogrammation dite IPS. D’après son concepteur, Fertilo imite un environnement ovarien jeune, reproduisant le processus de maturation naturel du corps en répondant aux besoins des ovules et en produisant les hormones et les nutriments nécessaires. Pour faire simple : la technique consiste à fabriquer artificiellement un milieu qui mime les conditions d’un ovaire, et contient des cellules capables de synthétiser ce dont les ovocytes ont besoin pour murir.
Un immense marché
Ces nouvelles techniques ont un potentiel de croissance immense. Gameto a obtenu l’autorisation réglementaire au Japon, en Argentine, au Paraguay, au Mexique et au Pérou. La société a également annoncé un partenariat avec IVFAustralia.
Un axe de recherche prioritaire en France
La restauration de la fertilité par maturation in vitro et in vivo (greffe tissulaire ou transplantation de cellules germinales) fait partie des thèmes de recherche prioritaire identifiés au sein du Groupe de travail « restauration de la fertilité » du Rapport fourni au Gouvernement en 2022 (Rapport sur les causes d’infertilité- Vers une stratégie nationale de lutte contre l’infertilité).
Limites et enjeux éthiques
Des études ont montré des résultats mitigés en termes de taux de maturation des ovocytes, de formation d’embryons, et certaines études montrent des taux de grossesse plus faibles que ceux obtenus en FIV classique. En réalité, il est extrêmement compliqué d’établir un « degré de maturation » satisfaisant pour les ovocytes.
Les auteurs d’une étude de recherche fondamentale estiment qu’une validation importante de l’utilité clinique sera « la capacité à générer des naissances vivantes en bonne santé ».
Ici se situe une question fondamentale : celle de l’impact sur la santé des enfants à naitre. En plus des questions et des enjeux éthiques liés aux techniques de procréation artificielle (consommation d’embryons, disjonctions entre union et procréation, entre procréation et grossesse, embryons surnuméraires…), on relève ici des enjeux sanitaires. L’ovocyte est la cellule qui constitue le zygote, une fois la fécondation réalisée. Cette cellule sert « de base » à toute la construction du nouvel individu. Il est difficile d’évaluer l’innocuité de techniques qui ne permettent pas de faire de réels tests préalables mais font de chaque enfant un test « grandeur nature » de la technique qui aura contribué à le concevoir et à le faire naitre.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :