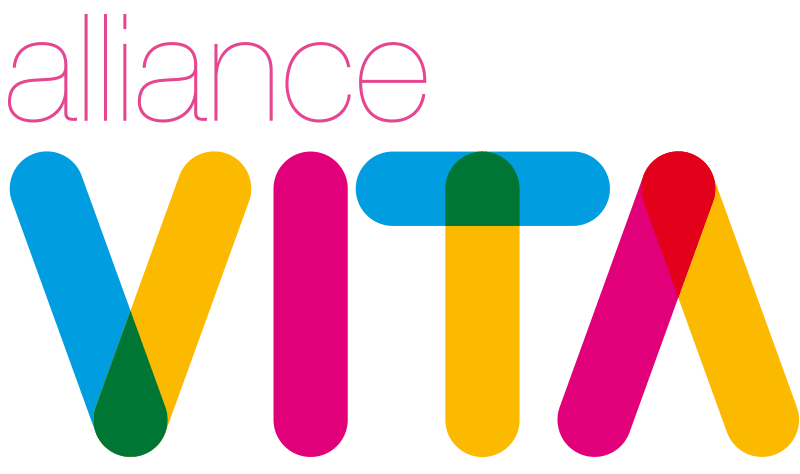Handicap, logement et discrimination
Vingt ans après la loi du 11 février 2005, les personnes handicapées subissent une injonction paradoxale. D’un côté ils reçoivent des message officiels de plein respect et de solidarité comme celui que leur adresse Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre chargée de l’Autonomie et du Handicap à l’occasion de cet anniversaire : « Nous voulons imaginer, avec tous les acteurs, une société où chacun trouve pleinement sa place. » Mais d’un autre le compte n’y est pas : logement, mobilité, emploi, accessibilité… C’est la protestation publique portée par les centaines de personnes en situation de handicap réunies à l’appel de leurs associations à Paris, place de la République, le 10 février pour marquer la commémoration de cette « belle loi ».
A l’occasion de la publication de son 30ème rapport sur le mal logement, la fondation pour le logement des défavorisés (anciennement la fondation Abbé Pierre) a également choisi de souligner les difficultés quotidiennes des personnes en situation de handicap sur ce thème du logement. La fondation décrit une réalité qu’elle dit « peu visible et méconnue ». Elle concernerait pourtant « 550 000 personnes qui vivent dans un logement inadapté à leur handicap, en surpeuplement accentué ou privé de confort. »
Ce constat confirme une situation contradictoire. « Prenez toute votre place ! » C’est le discours officiel adressé aux personnes vivant avec un handicap. Il a pris soin d’abandonner depuis longtemps le mot « intégration » pour lui préférer celui d’inclusion, afin de ne pas laisser entendre qu’il y aurait, d’un côté une société de valides, et, de l’autre, des personnes qu’il faudrait y intégrer – comme si elles étaient étrangères – à cause de leur handicap. Mais en réalité, beaucoup de personnes en situation de handicap constatent effectivement que la société n’est, dans une large mesure, pas faite pour elles, malgré les efforts et les progrès législatifs indéniables.
Les difficultés d’accès au logement (adapté) sont emblématiques. Alors que le handicap devrait être un facteur accélérateur pour obtenir un logement social, c’est l’inverse qui se produit : le besoin d’un domicile adapté augmente le délai d’attente. Quant aux bailleurs privés, même si c’est illégal, certains excluent ces demandeurs, dont les revenus sont faibles. Aux obstacles administratifs ou techniques s’ajoute donc la permanence d’une discrimination délibérée.
Elle est même comme instinctive chez une partie de nos concitoyens. Il ne s’agit plus de logements inadaptés mais de propriétaires ou de voisin indignes, qui trouvent mille prétextes pour empêcher l’arrivée dans un logement d’une personne porteuse de handicap. Parce que le handicap fait peur, parce qu’on estime qu’il gênera, que sa présence pourrait provoquer une dévalorisation des logements voisins ou la nécessité de travaux. La loi de 1989 précise pourtant qu’« aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire ».
La loi Elan permet quant à elle, depuis 2019, aux locataires en situation de handicap ou en perte d’autonomie de demander au propriétaire du logement l’autorisation de réaliser certains travaux d’adaptation. Un reportage de l’hebdomadaire La Vie ajoute un élément qui peut aider les « valides » à réaliser les conséquences d’incidents qui les affectent peu. Dominique Fonlupt y évoque « les 1,5 million de pannes d’ascenseurs annuelles, recensées par Ascenseurs en colère, un collectif citoyen lancé en septembre 2024. La durée moyenne d’immobilisation de quatre jours se traduit en une sorte d’assignation à résidence pour les personnes à mobilité réduite. » https://www.lavie.fr/actualite/societe/logement-et-handicap-la-discrimination-sevit-encore-a-tous-les-etages-97984.php
Certaines formes d’exclusion subies par les personnes en situation de handicap s’apparentent au racisme. Elles expliquent la montée des « antivalidistes ». Ce courant protestataire, porté par certaines personnes en situation de handicap se veut politique et radical. Ses membres estiment en substance que c’est le monde de ceux qui se prétendent valides qui crée leur handicap en les excluant d’une société conçue pour être inadaptée à leurs capacités. Leurs représentants sont venus manifester à Paris le 10 février pour contester les associations organisatrices de la manifestation : plusieurs gèrent des centaines d’établissements spécialisés dont les antivalidistes réclament la fermeture, au nom de la désinstitutionnalisation qu’elles prônent.
Au regard de ces problématiques, l’engouement pour les jeux paralympiques fait office d’évènement en trompe-l’œil. Il faudrait plutôt s’interroger sur la logique de discrimination et d’exclusion que subissent les personnes handicapées, et ce dès leur conception. Comment ne pas voir en effet qu’une culture de rejet quasi-systématique aux frontières de la vie des embryons ou des fœtus porteurs d’un handicap relève également d’une discrimination injuste ? En quoi la perspective d’une « grave anomalie » devrait elle entraver leur droit à la vie ? Personne – et certainement pas parmi les plus vulnérables – ne devrait être exclu de la solidarité.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :