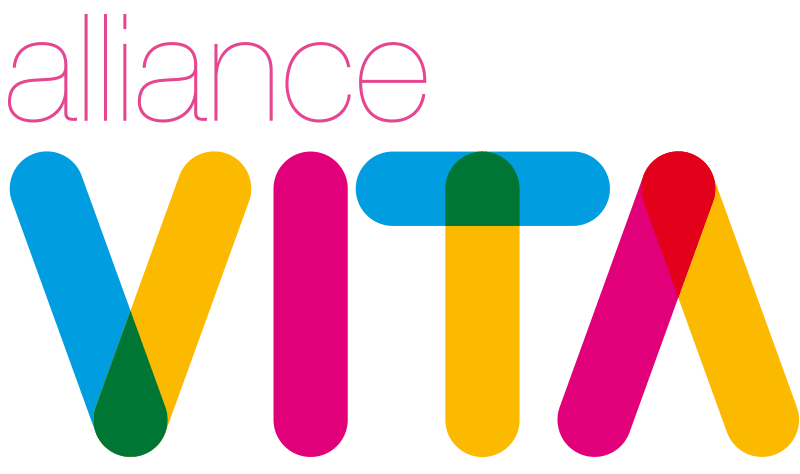Le grand tabou de la « détransition » de genre
Le phénomène de demande de « transition de genre » a explosé ces dernières années. L’académie de médecine parle d’un phénomène d’allure épidémique. Il ne concerne pas que les adultes, mais aussi les mineurs, les adolescents et parfois même des enfants. Ils sont en effet de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes à exprimer ce profond désarroi : avoir le sentiment d’appartenir à l’autre sexe que le sien, ou parfois à « aucun sexe ».
Entre 2013 et 2020, le nombre de demandes d’affection de longue durée (ALD) pour « transidentité» a été multiplié par 10. Les chiffres à l’échelle nationale concernant les mineurs n’existent pas, à ce jour, mais d’après la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en 2020, 8952 personnes étaient titulaires de cette ALD dont 294 âgées de 17 ans et moins. Les mineurs représentent donc 3,3 % de ces titulaires, mais il faut savoir que tous les parents de mineurs ne la demandent pas toujours pour leurs enfants.
Plus méconnus encore à ce jour, ce sont les chiffres qui concernent les personnes qui regrettent d’être entrées dans ces démarches et d’avoir soumis leur corps à des traitements hormonaux ou des gestes médicaux, comme l’ablation des seins, du pénis, de l’utérus et des ovaires, comme la phalloplastie (pose d’un phallus) ou la vaginoplastie. L’absence de chiffres nationaux sur les demandes de transition pour les enfants et les adolescents (ou la minimisation de ceux-ci) contraste donc avec l’importance de ce sujet chez les adolescents, les parents et l’institution scolaire.
Le Figaro cette semaine a publié une enquête sur ceux qu’on nomme désormais les « détransitionneurs ». Elle précise que les diverses études parlent de taux allant de 0,3%… à un tiers des cas. Mais toutes ne définissent pas le terme de la même manière, les cohortes sont souvent réduites, la méthodologie diffère et le suivi des personnes ayant « changé de sexe » ne se fait pas forcément dans la durée. L’ampleur de ce phénomène de détransition est donc encore largement inconnue. Est-il faible ou plutôt sous-estimé, voire invisibilisé ?
Des associations se créent à l’étranger
Dans plusieurs pays dont les USA, le Canada, le Royaume-Uni, la Belgique etc., il existe désormais des associations ou collectifs qui ont créé des sites de ressources en lignes de personnes détransitionneuses qui prodiguent des conseils et permettent de lutter contre les attaques dont elles font l’objet notamment sur les réseaux sociaux. Un forum international en langue anglaise, nommé subreddit / detransition rassemblait près de 51 500 abonnés fin 2023. Il en comptait 198 en octobre 2018, un an plus tard près de 7000.
Toutes ces personnes ne sont pas des détransitionneurs mais s’interrogent sur leur transition.
Censure et peur du mépris
En France, la recherche universitaire sur la détransition est peu développée. D’après le Rapport sur « la transidentification des mineurs » du Sénat de Mars 2024, certains chercheurs estiment qu’elle est frappée de censure dès lors qu’ils questionnent le sujet.
Du coté des personnes qui vivent ce besoin de « détransition », elles déclarent souvent ressentir une perte de soutien de leurs amis et de la communauté LGBT. Pour une militante proche de ce milieu : « ce sont des personnes très fragiles qui souffrent beaucoup du mépris de leur ex-communauté. Elles se cachent et évitent de s’exprimer en public ».
Des témoignages poignants
Dans l’enquête du Figaro, plusieurs personnes témoignent. Dont Jade, qui avait suivi un parcours incluant hormones, mastectomie et phalloplastie et qui se sentait de plus en plus mal. Elle réalisera au bout de 5 ans qu’elle s’est trompée. Elle a depuis repris son identité féminine et confie : « Je regrette et je regretterai toujours ». C’est le cas aussi de Julie, devenue Joseph. Un jour de 2021, elle partage sa détresse sur un forum de la communauté LGBT.
« Je regrette depuis des années d’avoir fait la transition, j’en suis malheureux de ne plus vivre en femme ».
Et puisqu’elle ne souhaite pas se lancer dans une détransition car « le rendu ne me conviendra pas », elle se retrouve « bloqué dans la vie en homme », dit-elle. Avant de fustiger une « erreur de jeunesse », elle pointe du doigt le « psy » qui lui a « donné l’accord pour les hormones au premier rendez-vous ». Dans cette « euphorie d’être androgyne » liée à son homosexualité, elle dit être allé « trop loin », ne pas avoir imaginé les « conséquences » de la vie une fois le changement de sexe effectué.
Après une mastectomie et une hystérectomie (ablation de l’utérus), elle a constaté une « discrimination au quotidien en amour » en tant que trans. Une « vie de paria ». « J’ai l’impression d’avoir gâché ma vie », conclut-il.
Le rapport du Sénat contient également ce type de témoignage :
« Je suis née de sexe féminin, mais j’ai toujours été plutôt garçon manqué dans mon enfance. À l’adolescence j’ai commencé à me sentir mal avec mon corps et ma féminité, c’est à ce moment-là que j’ai découvert la transidentité grâce aux réseaux sociaux ; c’est un concept qui venait comme une solution et une explication à tous mes problèmes et à partir de ce moment je me suis considérée comme un garçon. (…)
Après 1 an de suivi j’ai pu commencer la prise de testostérone à 15 ans. J’ai par la suite eu une mastectomie 1 an plus tard, à 16 ans. Tout ce parcours m’a aidé un temps à soulager le mal-être que j’éprouvais vis à vis de mon corps féminin ; j’éprouvais cependant des doutes par moment (est ce que j’ai fait le bon choix ? Est-ce que je suis en train de détruire mon corps ?) mais que j’arrivais à faire taire.
À 18 ans, après 2 ans et demi de transition médicale j’ai réalisé que je regrettais cette transition et les changements apportés à mon corps. (…) Je regrette d’avoir réalisé une transition médicale aussi jeune ; j’ai eu la sensation de solutions « baguette magique » à mon mal-être ; mais aujourd’hui je me sens bien en tant que femme, et je suis reconnue par mon entourage comme telle. Je continue d’apprendre à accepter mon corps comme il a été modifié à l’adolescence.
Vigilance et patience sont de mise
En 2022, l’Académie de médecine appelait l’attention de la communauté médicale et demandait qu’ »une grande prudence médicale soit de mise chez l’enfant et l’adolescent, compte tenu de la vulnérabilité, en particulier psychologique, de cette population et des nombreux effets indésirables, voire des complications graves, que peuvent provoquer certaines des thérapeutiques disponibles ».
S’adressant aux parents, elle recommande la vigilance face aux questions de leurs enfants sur la transidentité ou leur mal-être, en soulignant le caractère addictif de la consultation excessive des réseaux sociaux qui est néfaste au développement psychologique des jeunes et responsable d’une part très importante de la croissance du sentiment d’incongruence de genre.
Prendre le temps…
En Grande-Bretagne, le rapport Cass (lien), commandé par le National Health Service (NHS) a conclu que « l’incongruité de genre ne persiste [généralement] pas à l’adolescence », qu’un «soutien psychologique» et une «approche vigilante» sont généralement recommandés au lieu d’une «transition sociale» en raison des «risques» qu’elle comporte.
Parents tenus à l’écart : la faute d’un proviseur reconnu
Peu de temps avant la rentrée scolaire 2021-2022, une jeune femme a demandé aux conseillers d’orientation de son lycée de changer son prénom par un prénom masculin tout au long de son année scolaire. Une requête que le proviseur du lycée a acceptée sur le champ, sans en avertir ses parents et en sachant qu’ils n’étaient pas au courant. Ses parents découvrent cela trois mois après la demande de leur fille et ont décidé de saisir la justice.
Le tribunal administratif de Paris a estimé le 3 juillet dernier que le chef d’établissement avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Une loi pour protéger les mineurs
Le 28 mai dernier, une proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre était adoptée. Suspendue par la dissolution de l’Assemblée nationale, on ignore si elle reviendra au Parlement dans le prochain gouvernement. Au cœur du dispositif prévu, ce texte visait à interdire la prescription aux mineurs de traitements hormonaux, la chirurgie de “réassignation de genre” et à imposer que les mineurs présentant une dysphorie de genre soient accueillis dans des centres de référence spécialisés.
Pour la prescription initiale de bloqueurs de puberté, le texte imposait un délai d’au moins 2 ans entre la première visite dans le centre de référence et la prescription. Par ailleurs, il imposait une pluridisciplinarité de décision incluant un pédopsychiatre et un endocrinologue pédiatrique.
Pour aller plus loin, trouver des appuis
Ypomoni Collectif rassemblant des parents concernés par l’explosion des transitions médicales et chirurgicales rapides et irréversibles des enfants, adolescents et jeunes adultes. Ils ont publié un Guide à l’intention des parents confrontés au questionnement de genre de leur enfant et proposent des groupes de parole entre parents.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :