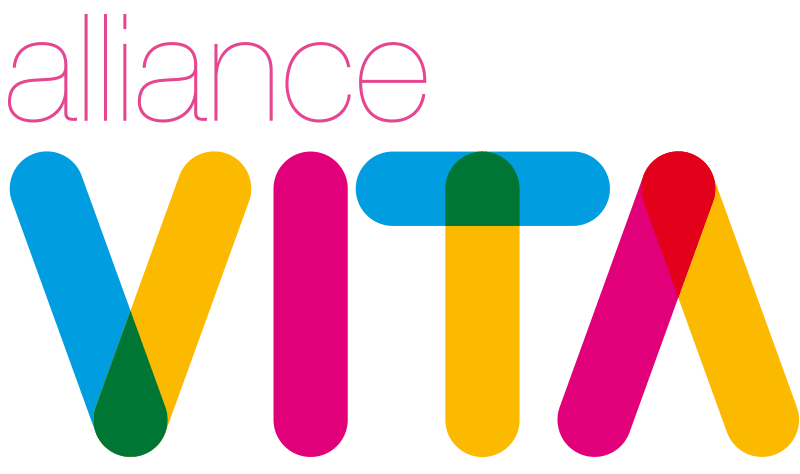Yvette est veuve, seule dans son petit pavillon de province, gérant sans se plaindre son cancer qui progresse. Son fils Alain sort de prison et s’installe « quelques jours » chez elle le temps de trouver un boulot, puisqu’il semble lui aussi très seul, sans femme et sans enfant. On attend, on espère l’affection d’une mère, le soutien d’un fils ; la solidarité familiale dans l’épreuve, tout simplement. On ne nous offre que silences taiseux, regards durs et méfiants, remarques acides de la mère contre paroles blessantes du fils !
De cet univers sombre, sans un sourire, sans un geste d’attention, sans un regard de tendresse, que peut-il sortir de bon ? Le drame psychologique nous saisit au fil des séquences, avec des portraits bien ciselés, des acteurs poignants dans leur incapacité à communiquer.
La seule personne montrant un peu d’humanité et d’attention, c’est le voisin, essayant sans succès de réconcilier cette mère et ce fils qui s’ignorent et se blessent mutuellement. Le seul capable de renouer un minimum de contact, c’est le chien, celui qui finalement recueille l’affection de chacun isolément.
Peut-on mettre en scène une mère plus raide, sans tendresse, enfermée dans ses petites habitudes, rappelant à chaque occasion à son fils qu’il est de trop (« Tu n’es pas chez toi ici ») ? Elle se montre incapable de faire le premier pas pour se réconcilier avec l’enfant qu’elle a mis au monde.
Peut-on faire un portrait plus triste d’un homme enfermé dans sa solitude rongée de honte, fatigué de ses échecs, totalement indifférent à la souffrance de sa mère (elle pleure avec de gros sanglots sur son lit, lui fume sa cigarette dans sa chambre à côté, sans bouger) ? Il se montre lui aussi incapable d’exprimer ses sentiments, sauf dans l’étreinte d’une rencontre passagère, sans passé et sans avenir (« J’avais envie… moi aussi… »).
Quelle issue reste-t-il quand votre propre fils vous jette à la figure, dans une nouvelle dispute aussi stupide que cruelle : « tu fais chier, t’as qu’à crever, j’en ai rien à foutre… » ? Et puisque les examens montrent que les traitements médicaux n’empêchent plus la progression du cancer, à quoi bon continuer à vivre une telle vie ? Quand la vieille femme annonce calmement, dans une froideur glaçante, qu’elle a organisé son suicide avec l’aide d’une association en Suisse, c’est presque un soulagement : « C’est au fond la seule décision que j’aurai prise dans ma vie », laisse-t-elle entendre, évoquant un mari dur et autoritaire. Encore cette exaltation de la soi-disant liberté individuelle, qui n’exprime pourtant qu’un désespoir profond, une solitude extrême, un appel au secours que personne ne veut entendre.
Car la bonne conscience de l’entourage est elle-aussi terrible. Celle du médecin lors du dernier entretien : « Votre choix, je le comprends et le respecte ». Celle des représentants de l’association suisse, mielleux dans leur mission d’explication de la procédure : « Vous savez que les soins palliatifs, c’est très bien… » ; « On s’occupe de tout » (sans dire que ça coûte des milliers d’euros…). Celle du voisin qui vient faire ses adieux et ne sait plus quoi dire. Celle du fils surtout, qui une fois passée la surprise et l’étonnement, n’exprime pas un mot pour la dissuader, pas un geste pour l’en empêcher, y compris dans les dernières minutes avant de boire la boisson fatale.
Et quand arrive enfin la seule étreinte entre la mère et le fils, c’est trop tard : le corps se raidit, les mains se détachent, la vie s’en va, et le fils va fumer sa cigarette dehors, sans une émotion.
Le réalisateur Stéphane Brizé dit ne défendre aucune thèse et laisser le spectateur à sa liberté de penser. Mais c’est trop facile de montrer le choix de la mort comme une solution naturelle, logique, simple, finalement « humaine », en comparaison d’une vie trop banale et « inhumaine ». La séquence finale du suicide dans un beau chalet en Suisse, orchestré par la femme de l’association avenante et tout sourire, dans un climat paisible et tranquille, voilà la violence suprême, la manipulation insidieuse.
Comment le suicide assisté peut-il être valorisé comme la seule issue souhaitable pour une vieille dame malade ? Dans ce film qui sert la cause de l’euthanasie sans vouloir dire son nom, ne faut-il pas plutôt voir le procès de la solitude, du mépris de l’autre, du « c’est votre choix » qui nous épargne toute solidarité réelle ?
Laisser croire que la mort donnée à soi-même peut être un choix libre et respectable, c’est la négation de toute solidarité humaine. A tout adolescent ou adulte qui demande le poison pour se supprimer, ou la corde pour se pendre, va-t-on lui procurer le moyen de se supprimer ? Non, au contraire, les proches et la société tout entière se mobilisent pour l’entourer, lui redonner goût à la vie, le sortir du désespoir. Mais quand il s’agit d’une personne âgée et malade, on renoncerait, on baisserait les bras, on lui dirait que sa vie ne nous intéresse plus, qu’elle peut disparaître sans que cela nous préoccupe ?
Quand la ministre chargée des personnes âgées, Michèle Delaunay, attirait l’attention des Français cet été sur le nombre de personnes âgées qui se suicident, ce n’était pas son message. Elle nous invitait au contraire à nous montrer plus attentifs et plus accueillants envers nos ainés, pour ne pas les laisser à leur solitude mortifère.
S’affirmer et se comporter en « solidaires des plus fragiles » : n’est-ce pas le seul avenir qui vaille ?